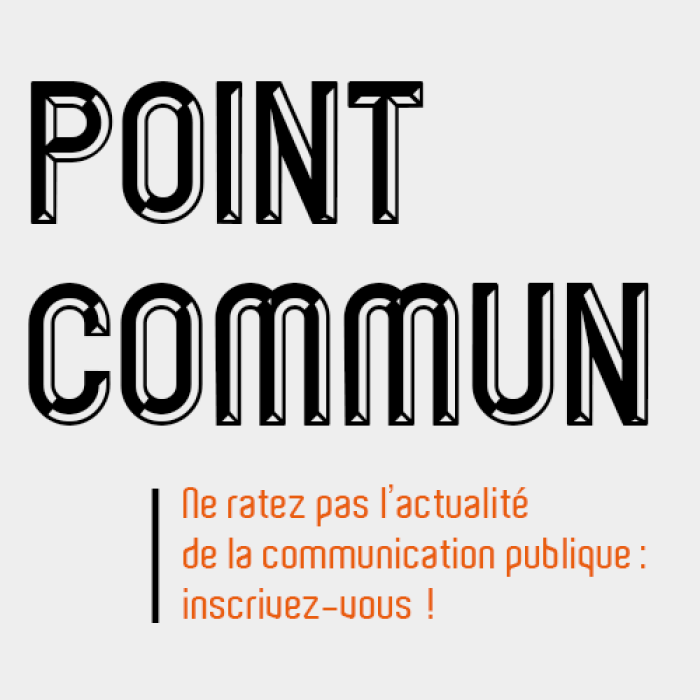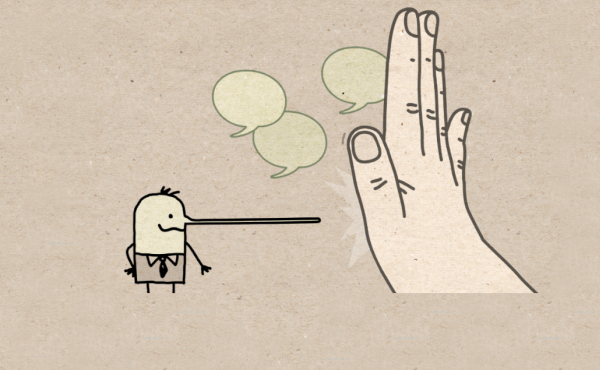Crise et vérité : comment renforcer la résilience démocratique à l’ère de la désinformation ?
Du 12 au 13 mars 2025, le Club de Venise a réuni à Londres les représentants de la communication publique européenne pour réfléchir ensemble à un défi commun : comment communiquer en temps de crise quand la vérité elle-même est devenue objet de controverse ? Aux côtés d’universitaires, de diplomates, de journalistes et de hauts responsables institutionnels, Natalie Maroun est intervenue pour le réseau Cap'Com dans la session « Se préparer à la crise », pour partager son constat : on ne répond plus aux crises comme hier. Elle partage ici les grandes lignes de son intervention.
Nathalie Maroun, est directrice associée du cabinet Element et experte gestion et communication de crise. Elle a accompagné Cap’Com sur ses formations et ses conférences sur le sujet.
Face à la désinformation, la communication publique change de terrain
Traditionnellement, la communication de crise repose sur des messages structurés, fondés sur des faits, validés par les institutions. Mais que faire quand la crise elle-même est alimentée par la remise en cause de ces faits ? Quand la question n’est plus de savoir si un problème existe, mais si ce que dit la science est encore audible ?
Car c’est bien là le cœur de la difficulté. La désinformation exploite l’asymétrie :
- elle joue sur l’impossibilité de prouver une absence (ex. : les punaises de lit à Paris – comment prouver qu’il n’y en a pas ?) ;
- elle se nourrit des émotions, des biais cognitifs et des croyances, là où la communication institutionnelle s’appuie sur des preuves ;
- elle prospère sur des plateformes qui vendent de l’attention, et non de la véracité.
En somme, nous affrontons des armées algorithmiques, appuyées par l’IA, quand nous continuons à manier l’arme lente mais éthique de la transparence.
Répondre autrement : comprendre les mécanismes, ne pas se tromper d’ennemi
Dans ce contexte, la communication publique doit éviter deux pièges :
- corriger mécaniquement des faits erronés sans en adresser les ressorts émotionnels ;
- se tromper de cible : le problème n’est pas uniquement le contenu, mais son impact sur les comportements, et donc sur la démocratie elle-même.
C’est pourquoi une approche « whole of society » s’impose. Il ne s’agit pas seulement de démentir, mais de renforcer l’immunité collective face à la manipulation :
- par l’éducation aux médias ;
- par le développement de la pensée critique ;
- par une meilleure maîtrise des algorithmes et des logiques de viralité.
Nous devons aussi développer des narrations alternatives, capables de toucher les citoyens dans ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent – pas seulement ce qu’ils savent.
Climat : un terrain d’affrontement et d’espoir
En tant qu’ambassadrice européenne du Pacte climat, j'ai rappelé comment les récits climato-sceptiques mobilisent des logiques de disqualification :
- la science est jugée politisée ;
- l’économie est érigée en victime des politiques écologiques ;
- les faits sont recontextualisés à l’extrême ;
- les catastrophes naturelles sont minimisées ou niées.
Face à cela, trois étapes semblent essentielles :
- identifier les techniques de manipulation ;
- mesurer leurs effets : affaiblissement de la légitimité publique, repli sur soi, comportements dangereux ;
- déployer une stratégie à deux niveaux : réponse rapide et plan de résilience sur le long terme.
Une mission publique, une éthique de la nuance
La communication de crise ne peut plus être cantonnée à l’urgence. Elle devient un levier stratégique de la résilience démocratique. Elle nous invite à changer de posture :
- moins dans la réaction, plus dans l’anticipation ;
- moins dans la preuve brute, plus dans la pédagogie ;
- moins dans la défense, plus dans la construction de récits collectifs.
Cette exigence est politique, au sens noble du terme : elle engage notre capacité à protéger les conditions mêmes du débat public.