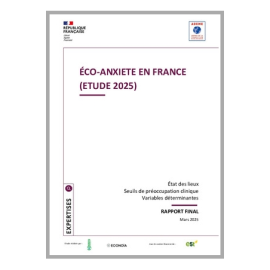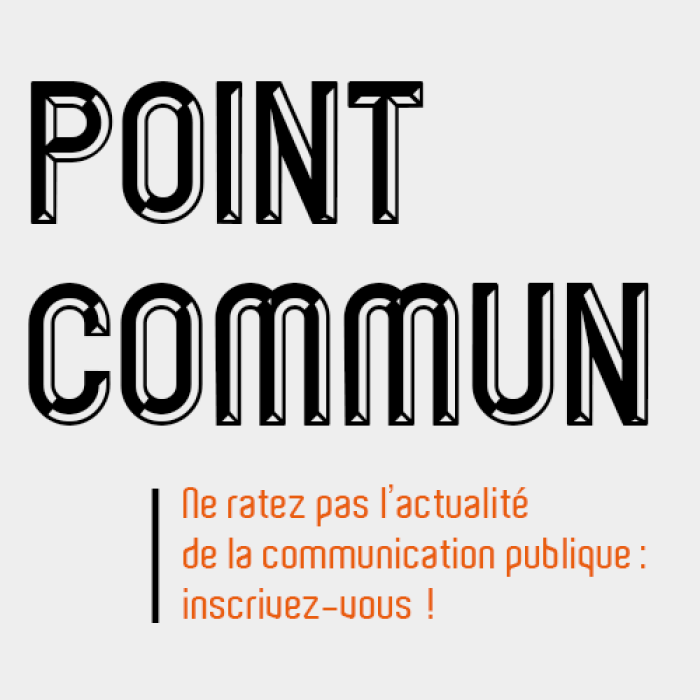Conseils pour lutter contre l’éco-anxiété
La question de l’éco-anxiété est omniprésente dans les médias, et des travaux universitaires existent sur le sujet. Mais la publication ce mois-ci de l’étude « Éco-anxiété en France » tente de mieux comprendre le phénomène et conduit à lister des actions que devrait mener la communication publique pour apaiser l’éco-anxiété.
Définie comme une détresse psychologique (un mal-être) découlant des inquiétudes face à la crise environnementale, l’éco-anxiété est un sujet de préoccupation dont se sont emparés les médias. L’étude, menée par l’Obseca et Éconoïa en partenariat avec l’Ademe, a souhaité pouvoir en établir un état des lieux de façon plus objectivée. Mieux comprendre qui est concerné et dans quelle intensité, car ce phénomène n'est pas toujours bien abordé.
Il n’existe pas une seule forme d’éco-anxiété, mais différents niveaux :
- ceux qui ne se sentent pas (ou peu) concernés ;
- ceux qui développent une éco-lucidité – une conscience aiguë mais régulée ;
- et ceux qui vivent une très forte éco-anxiété – un mal-être d’intensité élevée.
L’étude donne dans un premier temps quelques éléments chiffrés sur l’état d’esprit des Français. 75 % d’entre eux ne seraient pas vraiment éco-anxieux et 15 % seraient moyennement éco-anxieux avec de premiers symptômes qu’il convient de ne pas laisser s’aggraver. Mais 9 % seraient fortement ou très fortement éco-anxieux, et 1 % présentent un risque de basculer vers une psychopathologie tierce connue (dépression réactionnelle ou trouble anxieux). Et le phénomène touche toutes les catégories sociodémographiques même si les femmes, les jeunes, les plus diplômés, les habitants des territoires urbains sont plus éco-anxieux, tout comme, fatalement, les personnes se déclarant sensibles aux questions environnementales.
« Mais l’éco-anxiété peut être un moteur d’engagement potentiel, explique Valérie Martin, cheffe du service mobilisation citoyenne et médias de l’Ademe, et reconnaître l’éco-anxiété comme une prise de conscience légitime, et comme une éco-lucidité, c’est déjà commencer à l’apaiser. »
Promouvoir des communications proposant la vision d’un futur désirable
Toutes les actions déjà menées pour sensibiliser à la transition, pour proposer des solutions concrètes afin d’agir face aux enjeux environnementaux, vont clairement dans le bon sens pour atténuer l’éco-anxiété, explique l’étude. En effet, les actions d’éco-engagement rassurent l’éco-anxieux et apaisent son éco-anxiété. En particulier, il serait judicieux, poursuit l’étude, de conduire des politiques publiques pour prévenir la montée de l’éco-anxiété et limiter l’inquiétude des populations.
- Continuer à promouvoir, sur un plan sociétal et institutionnel, une politique volontariste de transition environnementale afin de donner à voir une espérance et contribuer à réduire l’éco-anxiété, avec des actions concrètes facilement actionnables par tous, où chacun peut faire sa part, même minime au démarrage : tous les gestes comptent. Un conseil qui s’adresse aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux.
- Promouvoir des communications donnant à proposer la vision d’un futur désirable, en accentuant la propagation de bonnes nouvelles – sans pour autant minimiser la prise de conscience des risques que l’humanité va devoir affronter – et en limitant les communications trop anxiogènes voire culpabilisantes. Un conseil qui s’adresse directement aux communicants publics.
- Valoriser les éco-anxieux comme étant dotés d’une certaine éco-lucidité sur l’état de la planète et des risques environnementaux, voire d’une certaine « éco-clairvoyance » sur ce qu’il faudrait faire pour faire avancer l’humanité sur la transition environnementale. Cette valorisation des éco-anxieux pourrait être utile pour les mobiliser sur les chantiers à mettre en œuvre pour la transition dont la société a besoin. Ce serait aussi le premier pas pour développer la résilience des populations face aux risques environnementaux qu’elles vont devoir affronter. Un second conseil qui s’adresse aussi aux communicants publics.
- Sensibiliser l’ensemble de la société à l’éco-anxiété, notamment les employeurs, pour prévenir et limiter les facteurs de risque – dans les organisations, associations et collectifs de manière générale – et accroître les facteurs de protection, par la mise en mouvement volontariste de ces mêmes organisations vers une transition, à même là aussi de rassurer les citoyens et plus spécifiquement les éco-anxieux. Un conseil qu’entendent les communicants internes des organismes publics.
Éco-anxiété en France (étude 2025)
Sutter, P.-E., Chamberlin S. & Messmer L.
Ademe
Avril 2025 - 86 pages
PDF téléchargeable gratuitement