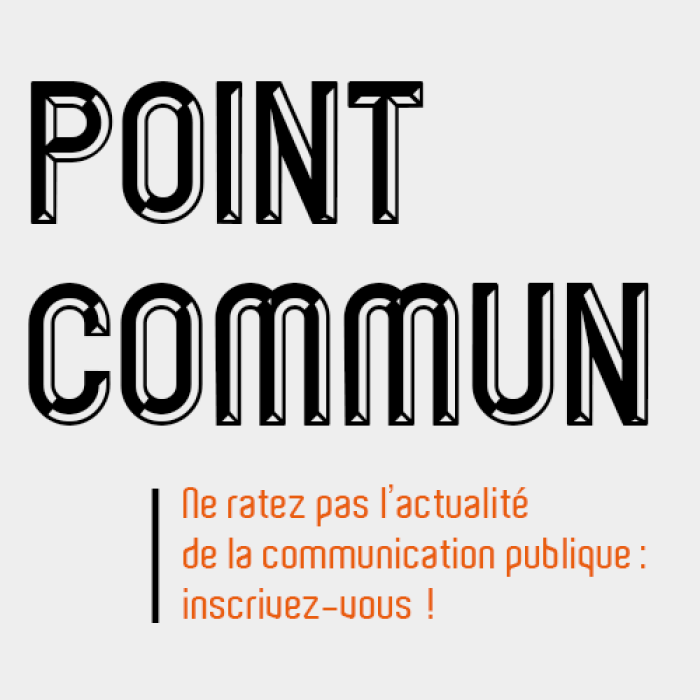La désinformation nous frappe au cœur
Sommes-nous préoccupés par la désinformation dans notre vie quotidienne ? Pas assez pour Klimentini Diakomanoli, auteure de « Fake news, que fait l’Europe ? » à paraître ce printemps. En lui confiant la présidence du Grand Prix Cap’Com, le réseau des communicants publics envoie un signal : toutes les formes de communication pâtissent désormais du double effet de la massification des infox et de la généralisation de la défiance.
L’année prochaine, les élections européennes risquent à nouveau de voir le débat démocratique obscurci par des opérations malveillantes. Pourquoi ? Comment ? Que faire ? En amont de sa participation à nos travaux, Point commun souhaitait interroger cette femme d’expérience sur l’objet de ses recherches et de son engagement déterminé.
Point commun : À quelles questions souhaitiez-vous répondre en entamant la rédaction de votre livre ?
Klimentini Diakomanoli : Des questions que tout un chacun se pose. Les interrogations de beaucoup de professionnels mais aussi de simples citoyens :
- quelles sont les fausses conceptions dont on parle beaucoup aujourd’hui et comment on les conçoit ?
- courons-nous un risque lorsque – peut-être naïvement – nous « partageons » des messages sur les médias sociaux sans réfléchir ?
- les géants mondiaux de la technologie, dans une démonstration d’arbitraire numérique, dirigent-ils nos comportements au point où la confiance dans la démocratie, la liberté d’expression ou la science s’érode ?
- et finalement, cette érosion de confiance nous empêche-t-elle de prendre de bonnes décisions ?
En tout état de cause, 83 % des citoyens européens considèrent la désinformation comme une menace pour la démocratie, et 63 % des jeunes utilisateurs numériques sont susceptibles de rencontrer de fausses nouvelles plus d’une fois par semaine.
83 % des citoyens européens considèrent la désinformation comme une menace pour la démocratie.
Klimentini Diakomanoli
D’autre part, le vieux continent s’avère être un leader mondial dans la lutte contre la désinformation et les « fake news » dans le monde numérique. Récemment l’Europe a obligé Facebook à supprimer 1,3 milliard de profils d’utilisateurs en trois mois « pour des raisons de sécurité ». Le règlement sur les services numériques, ou Digital Service Act (DSA), est, lui, entré en service ce 25 août.
Qui est la présidente du Grand Jury Cap’Com 2023 ?
Klimentini Diakomanoli, l’auteure de Fake news, que fait l’Europe ?, est spécialiste sur les questions de désinformation, et d’intelligence économique et politique.
Elle a une longue expérience professionnelle dans le domaine de l’information et du journalisme européens, surtout sur les questions de la recherche et la technologie, l’environnement et le changement climatique et la désinformation.
Elle a un Master of Arts en communication numérique et gestion de crise de l’université Aristote de Thessalonique. Elle est diplômée de la faculté de droit de l’université d’Athènes (GR), de Pau (F), avec un DEA en droit pénal et sciences criminelles, et avocate au barreau d’Athènes.
Point commun : Les réactions semblent donc à la hauteur. Pourquoi alerter ?
Klimentini Diakomanoli : Car le mal est profond. La désinformation en matière de santé publique ayant coûté des vies humaines au cours de la récente pandémie, le débat public en Europe autour des fausses nouvelles s’intensifie. Il s’avère de plus en plus nécessaire d’attaquer « intelligemment » le phénomène. Il est également nécessaire d’informer le citoyen-utilisateur de la technologie disponible sur la manière de gérer ces informations surabondantes dans un environnement numérique qui évolue de manière vertigineuse. Cet environnement n’est nullement exempt d’acteurs malveillants de toutes sortes.
Point commun : Alors quelle est cette menace ?
Klimentini Diakomanoli : Il s’agit en grande partie d’interférences depuis l’étranger - mais pas seulement - et de manipulations. On va un peu plus en profondeur ?
Point commun : Oui.
Klimentini Diakomanoli : On observe des stratégies pour influencer l’opinion avec des comptes fantômes et des bots. On utilise tout cela pour créer un environnement douteux qui génère un manque de confiance grandissant. L’objectif étant de détruire le crédit de la démocratie, de ses valeurs, d’attaquer les convictions comme l’espérance collective : faire un espace ou tout est flou, où il n’y a pas une réalité. On finit par s’interroger sur tout, pas avec le scepticisme des philosophes, mais plutôt avec la peur de ceux qui perdent leurs repères. Et cela est très dangereux dans une société, surtout pour les jeunes.
Dans le passé, le fou du village, chacun le connaissait, mais aujourd’hui il est caché derrière un faux profil sur le net.
Klimentini Diakomanoli
Point commun : Mais est-ce un phénomène si récent ?
Klimentini Diakomanoli : Est-ce qu’on a vu cela avant ? Oui, bien évidemment. Dans les périodes les plus sombres. Et même dans l’Antiquité, comme je l’explique dans mon livre, en Grèce antique. Mais ce qui se passe aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, est d’une autre ampleur. Il y a un espace public de discussion, à tout propos, sans limites. Un espace pour dire n’importe quoi, mais qui trouve toujours une audience, parce qu’il y a partout des gens pour croire. Dans le passé, le fou du village, chacun le connaissait, mais aujourd’hui il est caché derrière un faux profil sur le net.
Point commun : Comment peut-on lutter ?
Klimentini Diakomanoli : Avec la force de nos convictions démocrates et de nos institutions. J’ai travaillé à la Commission européenne pendant vingt-trois ans. J’ai un profil de juriste, devenue diplomate, qui travaille avec la presse et les professionnels de l’information. C’est naturellement que je me suis intéressée au sujet des infox et de la lutte qu’il faut mener. J’ai d’abord été confrontée à ces actions massives de désinformation et j’ai cherché à comprendre comment cela fonctionnait, comment cela pouvait nous atteindre malgré le fait que nous soyons conscients individuellement et collectivement. C’est ainsi qu’est née l’idée du livre. Pour sensibiliser, pour rassembler. Car la menace concerne tous les échelons de la vie démocratique, depuis les grandes institutions jusqu’aux échelons locaux et, finalement, au citoyen de tout âge.
L’Europe ne peut pas faire des fermes de bots dédiés aux infox ou des usines à trolls.
Klimentini Diakomanoli
Pour mon action professionnelle, je travaille au quotidien sur les opérations de désinformation touchant des pays membres de l’Union européenne sur les sujets que vous connaissez : guerre en Ukraine, migrations, climat, énergie. On doit lutter avec nos propres outils, avec des moyens différents de ceux utilisés par les groupes qui organisent cette déstabilisation par la désinformation. L’Europe ne peut pas faire des fermes de bots dédiés aux infox ou des usines à trolls. Mais elle doit être aussi forte que la Russie ou la Chine.
La période d’innocence est terminée. On doit avoir des réflexes très élaborés et avancés du point de vue technologique. C'est cela le défi. Pour lutter contre les opérations de sape menées depuis des centres situés en dehors de nos frontières, il a fallu identifier et soutenir près de 500 réseaux d’information à l’échelle des pays européens mais également des territoires et des villes. Nous travaillons de façon très intense. Nos collaborateurs vont dans les écoles pour faire de la média littéracie. C’est cette action en profondeur qui est importante. Car, si nous avons observé que la désinformation est partout, les relais complotistes et malveillants, eux, sont surtout implantés au cœur des régions (beaucoup moins dans les capitales). Au niveau local, les sociétés sont plus petites, et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela ne favorise pas le rétablissement des faits par la proximité, la possibilité de vérifier soi-même. Le bouche à oreille relaie plus facilement les infox destinées à déstabiliser les institutions démocratiques.
Point commun : Qu’est-ce qui vous a motivée pour pousser plus loin l’enquête et écrire ce livre ?
Klimentini Diakomanoli : La curiosité. J’étudie les phénomènes. Et il y a eu ces interrogations sur les élections européennes de 2019 : est-ce que les électeurs avaient été influencés par les réseaux sociaux et les infox ? En étudiant ce sujet, j’ai été passionnée. Une lutte a bien lieu, ici, maintenant. Et il ne faut pas nous sous-estimer. L’Europe est leader dans ce domaine, on est à l’avant-garde, bien que les plateformes des réseaux sociaux soient, et c’est une question majeure, aux États-Unis d’Amérique.
La désinformation fait rage, évolue et affectera la façon de penser et le comportement des générations futures.
Klimentini Diakomanoli
Mon livre présente un double angle de vue : je donne une vision personnelle mais je voulais aussi faire le lien avec un contexte européen. Je voulais penser comme une citoyenne, savoir comment me protéger de ces fausses informations et comment protéger mes enfants, car ils sont plus vulnérables. Initialement édité par les éditions de l’université de Macédoine (et donc dans ma langue natale), il sortira cet automne en français chez L’Harmattan, avec le soutien de Cap’Com. Il est l'aboutissement de ce long travail d’étude sur le phénomène de la désinformation aujourd’hui et sur la manière dont elle peut (ou ne peut pas) pénétrer la sphère cognitive du comportement des gens, au niveau politique, individuel et public.
Présentation du livre de Klimentini Diakomanoli à Strasbourg
Lors du prochain séminaire organisé par Cap'Com, conjointement avec le Club de Venise, l'autrice présentera son ouvrage qui sera sorti en Français (aux éditions L'Harmattan) et fera une intervention sur ce travail. Cet événement bilingue, diffusée en streaming et gratuit, aura pour sujet : "L’éducation aux médias et la lutte contre les fausses informations : un défi démocratique à l’échelle européenne". Il se tiendra le jeudi 23 mai 2024 à l’Eurométropole de Strasbourg.