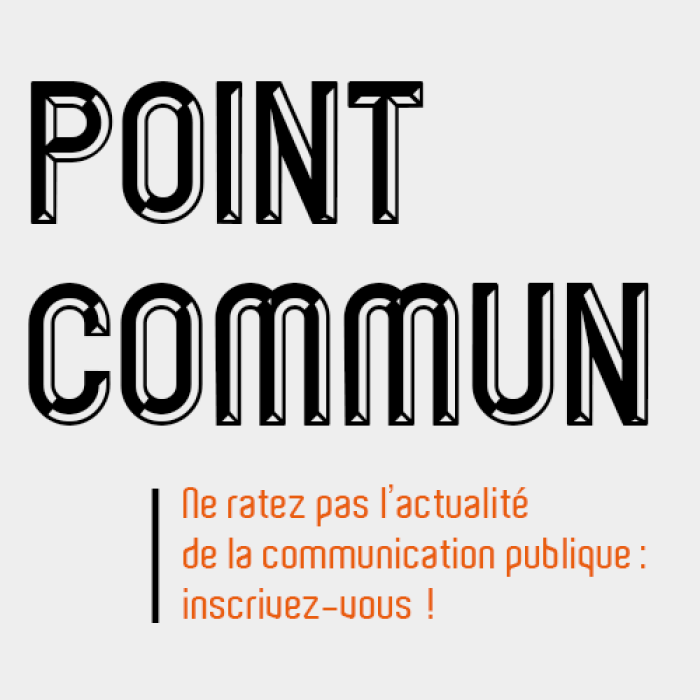Laëtitia Hélouet : « La communication publique doit parler à l’intime et au commun »
Présidente du Grand Prix 2025 de la communication publique et territoriale, Laëtitia Hélouet partage avec le réseau sa vision forgée par son parcours de haute fonctionnaire et sa fonction de présidente de l’Observatoire national de la politique de la ville. Consciente des fractures sociales, territoriales et citoyennes qui traversent la société, elle rappelle combien il est essentiel pour les collectivités de s’appuyer sur leurs atouts que sont la proximité, et leurs capacités d’ancrage et d’incarnation.
Point commun : Vos diverses expériences, et notamment votre rôle au sein de l’Observatoire national de la politique de la ville, vous permettent d’observer finement les inégalités territoriales et sociales. Quel est votre constat aujourd’hui ?
Laëtitia Hélouet : La politique de la ville, si je réponds sous cet angle, que je connais bien, a été créée sur le constat d’inégalité de certains territoires marqués par une concentration de pauvreté par rapport à l’aire urbaine environnante. Dans ce cas, il y a bien un cumul d’inégalités sur le plan social, comme territorial, qui justifie des moyens et des actions publiques spécifiques. Mais il ne faut pas opposer la politique de la ville, destinée aux quartiers populaires urbains, aux politiques qui visent les territoires ruraux. Ce sont deux modes d’action différents avec un objectif commun : contribuer à l’égalité des territoires et à l’égal accès aux services publics. Je pense que, lorsque l’on parle de lutte contre les inégalités, il faut avoir une approche globale : sociale et territoriale, urbaine et rurale.
Point commun : Lors de notre premier échange, vous évoquiez une fracture sociale en France. Qu’entendez-vous par là concrètement ? Quels signaux vous semblent préoccupants ?
L. H. : Dans la fracture sociale, il y a des éléments factuels (écart de revenus, situation dans le logement, etc.) auxquels s’ajoutent des éléments forts de perception, dont le sentiment de déclassement, celui de ne pas avoir sa place au sein de la collectivité locale ou nationale, ou pire, celui de ne pas être reconnu dans sa dignité. La fracture sociale se double, selon moi, d’une fracture citoyenne avec le sentiment d’inégal accès aux biens fondamentaux, comme celui d’avoir un système à double vitesse pour les territoires et donc leurs habitants, tant dans l’expression, la visibilité que dans la prise en compte des besoins.
Ce que j’observe également, c’est qu’il y a un paradoxe : il y a à la fois beaucoup de critiques qui peuvent être adressées aux services publics (coût financier, parfois procès en efficacité), et en même temps, beaucoup de demandes visant à avoir davantage de services publics. Pour réduire cet écart ou cette contradiction apparente, une communication de qualité est indispensable.
La communication publique n’est pas une communication comme les autres en ce sens. Dire ce que l’on fait au travers de l’action publique, c’est valoriser son utilité mais aussi contribuer directement à la transparence qui consiste à rendre compte de l’usage des deniers publics, ce qui constitue une demande forte de nos concitoyens. Lorsque cette communication est locale, c’est aussi permettre à chacun de mieux connaître les évolutions de son environnement de proximité et donc entretenir la qualité du lien local. C’est, enfin, la possibilité de communiquer sur des actions concrètes et donc de réduire ce sentiment, qu’ont parfois certains, que rien n’avance ou d’être laissés pour compte.
Dans un contexte de critique en légitimité et en efficacité de l’action des collectivités, une communication de qualité [...] devient un véritable levier de sécurisation de l’action publique elle-même.
Dans un contexte de démultiplication des canaux et d’illisibilité parfois organisée ou de fake news, une communication de qualité est un moyen important de valoriser l’action publique, d’informer le citoyen sur les sujets sur lesquels ses deniers sont investis et, plus globalement, de mettre en avant des initiatives et des projets concrets qui font avancer nos territoires.
Dans un contexte de critique en légitimité et en efficacité de l’action des collectivités publiques, une communication de qualité n’est plus seulement un moyen de diffusion d’information, mais devient un véritable levier de sécurisation de l’action publique elle-même. Une action publique qui n’est ni lisible ni comprise perd en soi une partie de son utilité et de la légitimité que l’on peut lui accorder.
Point commun : En quoi la communication publique et territoriale peut-elle, aujourd’hui, répondre à l’enjeu de visibilité et de transparence ?
L. H. : Comme évoqué précédemment, il y a un enjeu de transparence des actions publiques inscrit dans la Constitution. Pour y répondre, ou bien on le prend sur la « défensive », c’est-à-dire qu’on est simplement comptable de la façon dont on dépense l’argent public, ou bien on s’en empare comme un sujet à la fois d’information et d’incarnation qui permet de mettre en lumière les actions qui ont un intérêt collectif et méritent une visibilité particulière. Il y a une réelle possibilité en valorisant les initiatives locales, portées par les collectivités ou les acteurs locaux, de créer des synergies et de redonner ce sentiment de « bien-vivre » ensemble.
Quand on arrive à un certain niveau de complexité de l’action publique, le besoin d’incarnation et de proximité est essentiel et les collectivités locales ont de réels atouts en ce sens.
La communication que peuvent développer les collectivités territoriales a, en outre, une force particulière dans sa capacité à valoriser des territoires et leurs habitants.
Quand on arrive à un certain niveau de complexité de l’action publique (ce qui est souvent le cas), les besoins d’incarnation et de proximité sont essentiels et les collectivités locales ont de réels atouts en ce sens. L’action publique peut parfois être associée à une forme de « gigantisme » ; l’incarnation, sur laquelle peut s’appuyer la communication sur un projet local, remet les enjeux à hauteur d’homme.
Point commun : Et selon vous, quelle peut être la bonne manière de « dire les choses » pour créer de la valeur ?
L. H. : On a beaucoup parlé du fait que la communication peut valoriser des actions ou des acteurs publics. Mais elle contribue aussi à valoriser les dynamiques et initiatives portées par d’autres acteurs locaux ou des citoyens qui ont une réelle utilité publique ! Comment est-ce qu’on valorise, comment est-ce qu’on se porte ambassadeur des autres acteurs locaux, des habitants et de leurs talents, des innovations locales qu’il peut y avoir ? Là où l’action publique, parfois, peut moins en raison, notamment, de la contrainte budgétaire, elle peut créer de la valeur autrement : par la promotion des synergies des initiatives locales qui méritent davantage de visibilité.
Dans cette perspective, la communication publique a aussi l’intérêt de mettre en avant la vitalité du tissu local et de ses habitants.
L’anxiété liée au contexte politique national et international de cette rentrée renforce encore plus le besoin et la valeur de réponses de proximité.
Point commun : Vous estimez que les collectivités territoriales sont particulièrement bien placées pour répondre à ces défis. Pourquoi ?
L. H. : Oui, car, comme dit précédemment, elles sont des lieux d’incarnation et de concret. L’anxiété liée au contexte politique national et international de cette rentrée renforce encore plus le besoin et la valeur de réponses de proximité qui sont le propre des collectivités territoriales. La valorisation des initiatives locales sera plus que jamais un des pivots du lien social.
Point commun : En tant que haute fonctionnaire, quels sont selon vous les atouts des territoires que l’État n’aurait pas forcément ?
L. H. : L’ancrage. Et cet ancrage, aujourd’hui, est très précieux. Je pense que la chance qu’on a dans les territoires, c’est justement d’avoir un territoire avec toutes ses spécificités, qui définit un espace de vie et d’action. En communication territoriale, on peut mettre en visibilité le patrimoine culturel, le patrimoine environnemental, le capital humain attachés à chacun de ces territoires et ce qui peut les caractériser. C’est une force.
Le fait de parler de population à l’échelle d’un territoire particulier donne une compréhension plus concrète, y compris, à son échelle, d’enjeux globaux, et aussi une possibilité de mieux s’approprier son environnement de proximité, et, pourquoi pas, de développer une fierté autour de projets qui permettent de le préserver ou de l’améliorer.
Point commun : Quels sont les sujets fondamentaux dont devrait s’emparer la communication publique locale ? En tant que présidente du jury du Grand Prix Cap’Com 2025, qu’aimeriez-vous voir émerger ?
L. H. : ll y a l’inclusion. La communication publique sert aussi à dire : nous comptons toutes et tous et nous avons tous une place. Cette demande sociale et citoyenne est directement liée à des enjeux d’inclusion. Je sais que beaucoup de communicants font attention à cette question, qui reste une attente forte sur laquelle le moindre écart peut coûter cher. Il ne faut donc pas relâcher la vigilance, parce que cela renvoie à l’importance accordée à chacun et à sa contribution au bien commun, à la façon dont les personnes se sentent reconnues dans leur dignité, leur diversité et leurs valeurs. Ce lien de confiance n’est jamais un acquis. Et nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à aller le chercher. C’est à la fois ce qu’il y a de plus précieux pour nous, mais c’est constamment à refaire vivre.
Le sujet auquel je suis également très sensible, et qui explicite bien cette force de l’ancrage local, c’est la dimension environnementale, un des principaux défis, et qui ne pourra s’inscrire que dans une réponse collective. Valoriser davantage encore ce sujet donne aussi l’opportunité de mieux nous approprier nos territoires, notre patrimoine que sont, par exemple, nos forêts, nos rivières. Parce qu’on met de l’affect. Mettre l’accent sur le lien entre territoire et environnement, c’est une façon simple pour mieux comprendre les enjeux écologiques et ce que les efforts de chacun permettent de préserver. C’est-à-dire que l’ancrage territorial me permet de me dire : « Ce lac, là, juste à côté, j’ai envie qu’il soit propre pour mes enfants. » Et je pense que cette dimension de patrimoine environnemental est un bel exemple de comment est-ce qu’un enjeu global peut trouver des ressources fortes avec un ancrage et une réponse locaux.
Point commun : Comment la communication publique peut-elle contribuer à faire émerger d’autres manières de voir, d’autres regards ?
L. H. : Grâce à sa capacité à surprendre et à innover mais aussi sa capacité à embarquer, à redonner de la douceur, de la joie. Dans la communication, il y a quelque chose de formidable, c’est le fait de pouvoir parler au rationnel mais aussi aux imaginaires. La communication parle à l’intime et au commun à la fois : l’intime en étant capable de toucher quelqu’un dans sa singularité, ses émotions les plus personnelles, et le commun dans sa capacité à mobiliser les valeurs et un sens communs. Et, évidemment, quand on parle aux imaginaires de façon à faire envie, on crée d’autres moteurs dans l’action. Pour reprendre l’exemple de l’environnement, on peut agir avec le moteur du devoir ou celui de la culpabilité, mais on peut aussi avoir le moteur de l’envie : l’envie de prendre soin, de la joie de pouvoir profiter d’un environnement beau et préservé. Ça met une autre énergie dans notre façon d’agir.
Pour donner à voir des imaginaires qui valorisent le bien commun, l’ouverture à l’autre, l’argumentation rationnelle seule ne suffit pas ; il faut aussi embarquer l’expérience sensible.
Nous sommes aujourd’hui dans une guerre des imaginaires dont les acteurs publics doivent aussi tenir compte. Dans cette perspective, leurs actions de communication peuvent être une arme particulièrement utile. Pour donner à voir des imaginaires qui valorisent le bien commun, l’ouverture à l’autre, l’argumentation rationnelle seule ne suffit pas ; il faut aussi embarquer l’expérience sensible. Je pense en effet que l’expérience sensible a beaucoup de force. Si on ne me donne à voir qu’une version du monde, je peux finir par ne voir et ne croire que dans ce monde-là. Mais si on me donne à voir d’autres manières d’expérimenter et de vivre, je peux m’ouvrir à d’autres possibilités. Il me semble que la communication doit parler à l’intime et au commun, en donnant à voir des expériences sensibles et partagées. C’est aussi grâce à cela que les communicants publics pourront ouvrir de nouveaux imaginaires et donner davantage aux citoyens l’envie de se sentir acteurs de leur territoire.
Le Grand Prix 2025 de la communication publique et territoriale
Chaque année, les jurys du Grand Prix sont présidés par une personnalité, sollicitée pour le regard singulier qu'elle portera sur les campagnes de communication produites par les collectivités territoriales et les organismes publics. Pour cette 37e édition du concours – pour laquelle les inscriptions, gratuites, sont ouvertes jusqu'au vendredi 19 septembre –, c'est Laëtitia Hélouet qui présidera les débats. Elle analysera ainsi les campagnes candidates et apportera sa contribution exigeante et engagée aux travaux du réseau.