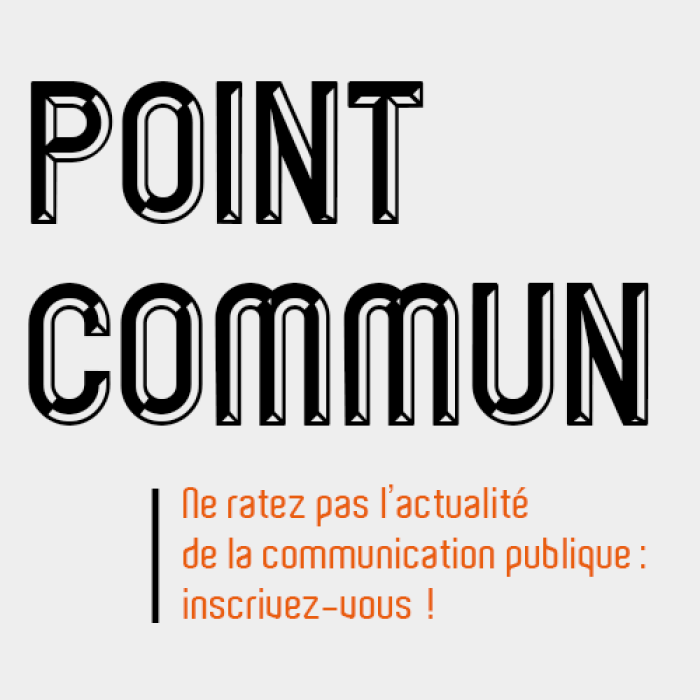L’ambivalence de la communication d’influence
Professeur en sciences de l’information et de la communication, Stéphane Olivesi s'interroge dans ses récents travaux sur la place croissante de « l’influence » dans nos pratiques communicationnelles. Alors que le mot s’impose dans les discours politiques, économiques ou médiatiques, il invite à dépasser la fascination pour les réseaux sociaux et à repenser l’influence à l’aune du pouvoir symbolique des grands acteurs économiques. Une réflexion stimulante pour les communicants publics, appelés à discerner ce qui, dans leurs actions, relève de la conviction ou de la croyance en leur propre capacité à « influencer ».
Philosophe de formation, docteur en sciences politiques (IEP de Rennes), Stéphane Olivesi est professeur en sciences de l’information et de la communication. Dans ce cadre, il dirige le master « Politiques de communication & développement des organisations » en apprentissage à la faculté de droit et de science politique de l'université Versailles Saint-Quentin. Ses enseignements portent principalement sur : les idées politiques et la théorie politique ; les sciences de la communication ; la communication des organisations. Cet entretien a été réalisé suite à la publication dans le numéro 50 de la revue Communication de son article « Communication d’influence ».
Point commun : Vous écrivez que « l’influence » tend parfois à se substituer à la dénomination « communication ». Qu’est-ce que cela traduit des évolutions de nos pratiques ?
Stéphane Olivesi : Il y a deux manières d’appréhender et de définir les phénomènes dont on parle : en proposant une définition nominale ou une définition réelle. Je préfère écarter toute définition cherchant à différencier le registre de la communication et celui de l’influence parce que les pratiques se confondent et les acteurs mobilisent indistinctement ces catégories en fonction de leurs intérêts. L’exercice serait donc vain et l’on tournerait rapidement en boucle en se payant de jeux de mots : « communiquer n’est pas influencer ». Je constate simplement des flottements dans l’usage de ces termes, mais aussi des évolutions et de nouvelles mobilisations de ces notions. En généralisant le trait, on peut retenir que la référence à l’influence est de plus en plus présente dans les discours d’acteurs divers qui relèvent des mondes économiques et politiques, mais aussi académiques et journalistiques. Cette notion a certes une très longue histoire mais, aujourd’hui, les acteurs de ces différents mondes se la réapproprient pour qualifier ou caractériser des registres de pratiques.
Alors comment expliquer leur engouement pour « l’influence » ? Faut-il y voir le symptôme d’une certaine impuissance et/ou l’expression d’un souci croissant d’efficacité, dans le domaine de la communication ? N’y a-t-il pas aussi résurgence d’un vieux fantasme de manipulation qui a accompagné l’histoire des médias et qui plonge ses racines dans l’histoire sociale mouvementée du XIXe siècle ? Cela témoigne en tout cas d’une chose : l’emprise croissante de la communication dans tous les domaines de la vie sociale et économique.
Point commun : Est-ce qu’influencer s’apparente toujours à une forme de manipulation ?
Stéphane Olivesi : Je ne sais pas ce que c’est qu’« influencer ». Comme je viens de l’indiquer, je ne m’approprie aucune définition. J’emprunte aux acteurs les définitions qu’ils proposent ou, plutôt, qu’ils engagent au travers de leurs discours et de leurs pratiques, sans en maîtriser totalement la signification sociale. En tout cas, le plus souvent, l’idée de manipulation se dissimule derrière les conceptions courantes de l’influence. C’est ce qui explique son succès, sous l’angle positif (on vend de l’influence) mais aussi négatif (on dénonce l’influence). C’est aussi ce que je me propose de critiquer : on espère manipuler ou, inversement, on dénonce les risques de manipulations ; on espère aussi convaincre de sa capacité à influencer/manipuler pour faire valoir une offre de service. Mais il faut bien distinguer ce qui relève de croyances partagées et, par ailleurs, la manière dont des pratiques sont développées et opèrent.
Mon collègue de l’université Rennes 2, Stéphane Laurens, a proposé un article éclairant sur la croyance en l’efficacité persuasive du message publicitaire. Si vous n’aimez pas le camembert, aucune publicité ne vous fera acheter du camembert. En revanche, si vous aimez les camemberts au lait cru, longuement affinés, produits avec du lait de Normandie provenant de vaches de race normande et que les services marketing parviennent à faire produire un camembert répondant aux attentes du type de consommateur que vous êtes, alors la mise en visibilité du produit par la publicité peut en effet fonctionner comme une information déterminant l’acte d’achat, mais cela ne signifie nullement que vous soyez influencé/manipulé. On a simplement produit ce que vous attendiez, et cette attente dépend elle-même d’une forme d’acculturation, autrement plus structurante.
Point commun : Dans cette récente publication, vous préconisez de prendre en compte la capacité d’influence globale des entreprises (pas seulement le recours aux influenceurs). Cette capacité a-t-elle augmenté récemment avec les outils numériques et les réseaux ?
Stéphane Olivesi : Dans l’article que vous évoquez, je propose un changement de focale, tendance « jeune Marx » ou, si vous préférez, un renversement de perspective ! L’idée est simple : plutôt que de se focaliser sur des microphénomènes ou des phénomènes qui, à l’échelle de la société et de son économie, sont relativement peu signifiants (les trop fameux influenceurs des réseaux sociaux), mieux vaut se tourner vers les groupes d’intérêt qui ont la puissance – c’est-à-dire le capital – pour produire du droit, de la science, de l’information. On peut certes s’intéresser à ces microentrepreneurs, analyser leur manière d’agir en ligne et leurs tentatives visant à marchandiser leur capacité d’action. Il s’agit là d’un objet d’étude intéressant en lui-même. Mais il faut surtout ressaisir ces problématiques d’influence en termes d’hégémonie, de monopolisation des ressources symboliques permettant de produire et d’imposer des systèmes de représentations à l’échelle de la société.
La concentration des ressources symboliques est le cœur de la problématique de l’influence : il s’agit moins de manipuler que d’imposer des manières contraintes de penser et d’agir.
La concentration des ressources et des moyens d’action symbolique dans les mains quasiment exclusives des détenteurs de ce que l’on osait appeler par le passé « le grand capital » constitue le cœur de la problématique. À partir de cette concentration de ressources, les systèmes de représentations font l’objet d’un contrôle exclusif visant non pas à manipuler des âmes manipulables mais à imposer uniformément des manières contraintes de penser et d’agir. Les chercheurs en communication n’évitent que rarement le médiacentrisme, comme les chercheurs en science politique perpétuent la croyance essentialiste en la centralité du pouvoir politique. C’est la raison pour laquelle il faut reconsidérer la formule de Gramsci : l’hégémonie part de l’usine et non pas des médias ou du pouvoir politique.
Pour répondre au second volet de votre question, je dois préciser que je ne suis pas spécialiste des outils numériques et des réseaux sociaux, mais je crois qu’il est impératif de sortir d’une appréhension morale et de les appréhender économiquement. S’ils drainent des flux de capitaux importants, ils ne jouent pas un rôle déterminant, voire un rôle de premier plan, dans la plupart des actions de lobbying. On peut prendre un exemple récent, certainement caricatural mais révélateur : si le lobby des producteurs de betterave est parvenu à faire la loi (1), ce n’est pas au moyen ou grâce aux réseaux sociaux. Dans ce cas, les réseaux sociaux, à l’égal des médias « grand public », n’ont joué qu’a posteriori dans la mobilisation sociale contre les dispositions d’une loi qui ne tenait guère compte de la santé publique et de l’environnement. En bref, il faut se détourner de la focale « réseaux sociaux », mais c’est très difficile pour les journalistes et pour un certain nombre d’universitaires, parce qu’ils tendent à n’entrevoir le monde social que par cette fenêtre qui est un miroir déformant.
La marchandisation de l’influence commence par la croyance en sa propre capacité à influencer.
Point commun : Beaucoup d’acteurs de la communication se présentent aujourd’hui comme des influenceurs. Mais font-ils tous la même chose ?
Stéphane Olivesi : Non, évidemment. Il y a des différences de domaines d’intervention et de pratiques, mais surtout d’énormes différences économiques : point de commune mesure avec un « influenceur » sur les réseaux sociaux qui vise un complément de revenu et une agence de communication qui œuvre pour un puissant lobby, une multinationale, voire un pays. Le problème se ramène, une nouvelle fois, à la mobilisation de cette commune référence à l’influence sous la bannière de laquelle se rangent une diversité d’acteurs dissemblables. Et l’on peut supposer que l’élément explicatif principal réside dans la promesse que fait l’acteur qui se définit comme « influenceur » à l’égard de ceux à qui il vend ses services. S’afficher comme influenceur, c’est promettre que l’on peut et que l’on sait agir sur un large public « cible » au profit de ceux qui recourent aux services de l’influenceur. La marchandisation de l’influence commence par le travail consistant à s’autopromouvoir comme influant…
Point commun : Pour vous, les influenceurs sur les réseaux sociaux sont des relais de proximité. S’agit-il d’une communication plus horizontale ?
Stéphane Olivesi : Pour vous répondre, il faudrait prendre sa loupe et essayer de catégoriser ces « influenceurs » des réseaux sociaux sur la base d’une construction idéaltypique rigoureuse permettant de comprendre leurs rapports à leurs audiences, les services ou les marchandises dont ils font la promotion, le type de relation qu’ils nouent avec les commanditaires et, enfin, leur profil social et économique. Dans certains cas, ils peuvent fonctionner comme des relais effectifs de proximité parce que, socialement, ils sont réellement en relation ou sont culturellement proches de ceux avec qui ils sont en relation. On peut aussi avoir des influenceurs beaucoup plus distants des publics qui les suivent sur les réseaux sociaux mais qui produisent une illusion de proximité. C’est le cas de « stars », issues des mondes du sport ou du spectacle. Mais on peut aussi relever que ces « stars » donnent une série de signes d’appartenance à un même monde social que leur public, partagent souvent des codes de la culture populaire, jouent sur des stéréotypes largement diffusés.
(1) On fait évidemment référence à la loi « Duplomb » de 2025, proposée par le sénateur Laurent Duplomb, qui a suscité contre elle une pétition recueillant plus de 2 millions de signatures.