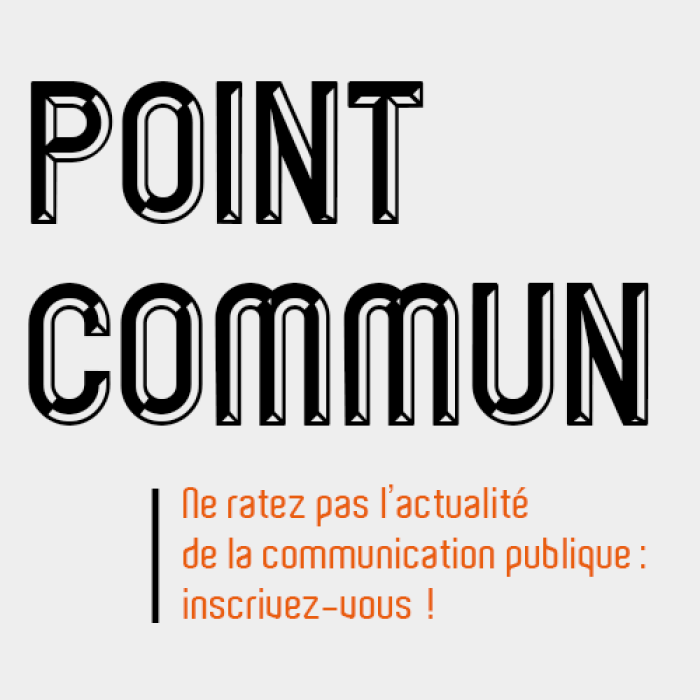Les communicants publics, nouveaux griots du récit collectif
Philosophe et autrice, Emma Carenini explore la puissance du récit dans nos sociétés fragmentées. Pour elle, raconter n’est pas un simple art de dire, mais une manière d’agir sur le monde. Dans cet entretien, elle évoque le rôle du communicant public comme « griot contemporain », capable de régénérer le lien social par la narration et la compréhension du réel. Une réflexion sur le pouvoir du « méta-récit », entre mythologie, vérité et action.
Emma Carenini est professeure agrégée de philosophie, cofondatrice de Phronimos, autrice de Soleil. Mythes, histoire et sociétés (PUF). Elle fut conseillère discours et éducation artistique et culturelle au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Ses travaux portent en partie sur la pensée du commun, la place du récit dans les sociétés contemporaines et les relations entre vérité, émotion et action, d’où son invitation à la plénière d’ouverture du 37e Forum Cap’Com à Angers. Elle a été auditionnée par le Comité de pilotage de Cap’Com le 2 octobre 2025 à Paris où elle a évoqué la manière dont les récits forgent nos liens sociaux et redonnent sens à la parole publique.
Point commun : Quel est le rôle des communicants publics dans la construction de ce méta-récit, dans une période où les budgets sont en baisse, où, justement, la communication publique a tendance à être de plus en plus en retrait ?
Emma Carenini : Le rôle des communicants publics est immense. Pour saisir cette fonction, on peut s’amuser à la comparer à ce qu’on appelle les « griots » dans certaines sociétés africaines. Ces conteurs publics interviennent précisément lorsque la communauté traverse une crise ou subit une fracture. Leur mission consiste alors à rappeler l'histoire commune, à réactiver le méta-récit fondateur qui justifie l'existence collective et explique pourquoi ces individus forment une communauté.
Le communicant public contemporain exerce une fonction analogue. Il possède la maîtrise technique du récit et dispose d'un capital narratif qui lui permet d'ordonner les faits, de déterminer leur mise en forme et de choisir les images appropriées. Cette compétence s'avère d'autant plus cruciale que les codes de réception évoluent constamment. Le communicant public devient ainsi l'artisan d'une cohésion sociale par la narration, capable de produire ce ciment symbolique dont toute collectivité a besoin.
Cette dimension n'est pas accessoire : les régimes politiques se fondent sur des récits, tout comme les stratégies publicitaires. L'imaginaire collectif se nourrit de ces constructions narratives. Dans cette perspective, le communicant public occupe une position stratégique pour agir en pleine conscience de ces enjeux.
Point commun : Comment voyez-vous un récit collectif qui n'est pas personnifié, mais qui est incarné, si l’on peut dire, par une terre, par un territoire ?
Emma Carenini : L'auteur du Seigneur des anneaux a construit son œuvre à partir d'un attachement profond à son territoire et à sa culture. Il a élaboré une mythologie complète, dotée d'un système cohérent de personnages, de lieux cartographiés avec précision, d'histoires enchâssées les unes dans les autres. Son projet visait explicitement à créer un récit territorial, une nouvelle mythologie pour la culture anglo-saxonne.
Quand le récit émane d'un territoire plutôt que d'ambitions individuelles, il atteint un niveau mythologique. Le mythos opère directement sur l'imaginaire collectif et vise une résonance universelle plutôt que particulière. Ce type de récit transcende les intérêts personnels pour toucher à quelque chose de plus fondamental dans l'expérience humaine commune.
L'histoire, parce qu'elle captive les gens, est un instrument de pouvoir.
Point commun : Raconter une histoire peut être très positif. Tout le monde écoute. On va transmettre et on va partager des émotions et des choses en commun. Mais on peut aussi « raconter des histoires », des balivernes. Est-ce bien deux faces d’une même expression ?
Emma Carenini : C’est une anecdote très personnelle. Quand j'ai passé l'agrégation de philosophie, il y avait un sujet à l'oral qui circulait : « Se raconter des histoires ». Ce sujet est très ambigu. Il me plaisait, je ne suis pas tombée dessus, mais je suis heureuse de pouvoir en parler avec vous aujourd’hui. Cette ambivalence constitue effectivement le cœur du problème narratif. L'expression « se raconter des histoires » révèle parfaitement cette dualité : elle désigne à la fois la capacité humaine fondamentale à créer du sens par le récit et la tendance à l'auto-illusion. Cette dimension réflexive – « se » raconter – introduit la possibilité de la tromperie et de l'aveuglement volontaires. Le nazisme a démontré la puissance destructrice du récit instrumentalisé. Le mythe de la « race supérieure » et du lebensraum a mobilisé tout un peuple dans un projet génocidaire. Staline a réécrit l'histoire soviétique, effaçant ses opposants des photographies et des archives pour construire un récit linéaire de la révolution. Ces exemples montrent comment le contrôle narratif devient un instrument de domination totale. La « mission civilisatrice » française ou le « fardeau de l'homme blanc » britannique ont légitimé la colonisation en présentant la domination comme un bienfait. Ces récits ont permis aux métropoles de justifier l'exploitation tout en se donnant bonne conscience. Une société peut très bien se raconter des histoires pour supporter l’insupportable. Comme le démontre Yuval Harari dans Sapiens, la capacité narrative constitue une spécificité anthropologique fondamentale. Mais précisément parce qu'elle captive si puissamment les individus, elle devient inévitablement un instrument de pouvoir. Cette ambivalence exige une vigilance constante. Le récit peut libérer en donnant du sens à l'expérience, mais il peut également asservir en imposant des fictions qui servent des intérêts particuliers.
Point commun : Vous avez, lors de votre intervention, parlé de l'orateur qui s’accroche au réel, pour trouver une forme de sincérité et d'authenticité aussi. Est-ce que, dans ce rapport au réel, notamment en période de crise, le fait de pouvoir faire état d'une fragilité, d'un point faible, n'est pas une forme de force ?
Emma Carenini : Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je mobiliserai ici un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Spinoza. Baruch Spinoza dit une chose très simple : on n'est libre dans la vie qu'à partir du moment où on comprend ce qui se passe autour de nous, dans notre vie. Je simplifie, évidemment, mais au fond c'est ce qu'il dit. Nous ne devenons libres qu'à partir du moment où nous saisissons l'enchaînement causal qui a produit une situation donnée – qu'il s'agisse d'un conflit, d'une relation problématique ou d'une catastrophe territoriale. Cette compréhension nous donne prise sur la réalité car nous identifions les leviers d'action possibles.
Il y a un lien entre le récit, la vérité et l'action.
L'être humain n'agit jamais en dehors de la nature ni des causes qui traversent le monde. Si nous comprenons ces causes, nous pouvons agir sur elles. Le récit devient alors un instrument d'explicitation : il permet de dire « voilà ce qui s'est passé, voilà comment nous allons le raconter, voilà où se trouvent les leviers d'action ». Cette démarche crée les conditions d'une action lucide et efficace. Le récit établit ainsi un lien direct entre vérité, compréhension et possibilité d'agir. Il y a un lien entre le récit, la vérité et l'action.
Point commun : Est-ce que vous voyez émerger de nouveaux méta-récits ?
Emma Carenini : La question écologique pourrait constituer l'exemple le plus évident, mais elle révèle une transformation inquiétante. Contrairement aux époques antérieures qui produisaient des utopies (de Thomas More à Tommaso Campanella), notre époque semble incapable de concevoir des sociétés idéales désirables. L'imaginaire utopique a cédé la place aux dystopies, ces récits d'effondrement et de catastrophe. Cette mutation affecte également les méta-récits contemporains. Le récit écologique dominant présente l'humanité comme engagée sur une trajectoire de destruction. Ce méta-récit, bien que fondé sur des réalités tangibles, manque de cette dimension positive et mobilisatrice qui caractérisait les grands récits collectifs du passé. Nous assistons peut-être à l'émergence de méta-récits structurellement pessimistes, ce qui pose la question de leur capacité à susciter l'engagement et l'action collective.
Avec l'IA, l'enjeu dépasse la prolifération des récits artificiels : il concerne la capacité des sociétés humaines à conserver la maîtrise de leur propre production symbolique.
Point commun : Aujourd’hui il y a un autre acteur dans la construction des récits : l’IA
Emma Carenini : L'intelligence artificielle introduit effectivement une rupture majeure dans l'économie narrative. Elle constitue une force génératrice de textes qui colonise progressivement l'espace narratif, s'alimentant de l'ensemble des contenus disponibles sur internet. Nous assistons à l'émergence d'un écosystème où les histoires sont produites par l'IA, relues par l'IA, puis résumées pour la consommation humaine.
Cette évolution conduit certains observateurs à formuler l'hypothèse du dead internet : un réseau où l'intégralité des contenus – récits, discours, productions symboliques – serait générée par des algorithmes. Au-delà de la simple concurrence entre récits, cette situation pose la question de la captation de l'imaginaire humain par des dispositifs techniques. L'enjeu dépasse la prolifération des récits artificiels : il concerne la capacité des sociétés humaines à conserver la maîtrise de leur propre production symbolique.