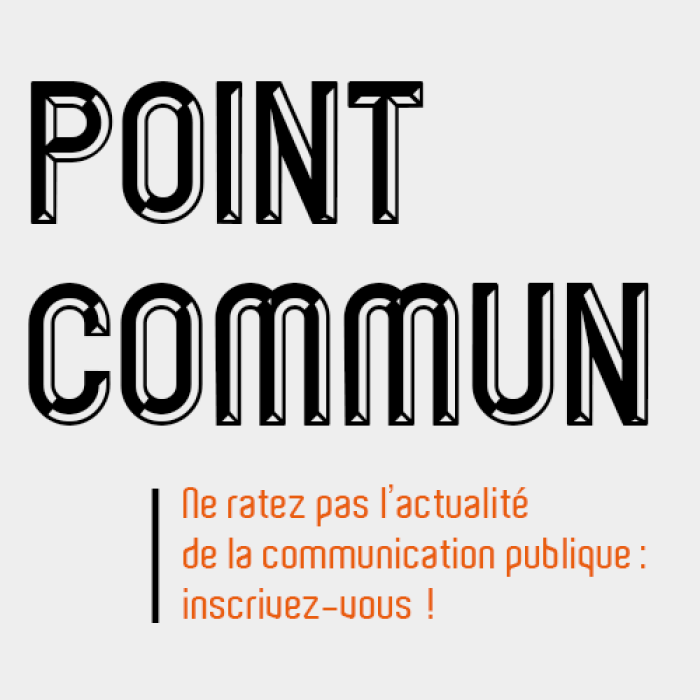Assaël Adary : pour une définition commune de la communication
Il y a la publicité et il y a la communication, dont la communication publique pourrait être une forme plus exigeante et responsable… ou alors un grand tout. Nous avons posé la question à Assaël Adary, coprésident de l’Association nationale des communicants et DG d’Occurrence-Groupe Ifop, qui défend une vision transversale de nos métiers, avec des valeurs et des enjeux communs. Son approche œcuménique et sincère en fait un défenseur de la communication au sens large. Avec des convictions chevillées au corps, un sens du collectif et une conscience, il regarde avec beaucoup d’intérêt tout ce qui vient de la communication publique.
Assaël Adary, observateur et animateur
Il est DG d’Occurrence-Groupe Ifop, coprésident de l’Association nationale des communicants et également connu pour être coauteur du Communicator, dont la 10e édition vient de paraître chez Dunod. Cette « bible » de la com est utilisée par tous les étudiants de nos filières en France et intègre dans cette édition aussi bien de vrais morceaux de pub que de nombreux exemples de communication publique authentique. Et il y a naturellement un article consacré à notre profession, signé Cap’Com.
Cette dernière interview avant l’été, qui nous a été accordée lors du Spot Festival, près de la passe du bassin d’Arcachon, de ses bancs de sable et de ses courants, pourra nourrir nos réflexions d’ici septembre !
Point commun : Vous parlez de zones de rencontres importantes entre tous les aspects de la communication. Pourtant, du point de vue des communicants publics, leur domaine est exigeant et ils travaillent dans un cadre de service public qui les oblige. Vous, vous y voyez plutôt des points communs ?
Assaël Adary : Oui, c’est peut-être mon côté optimiste – mais je vois de nombreuses opportunités d'horizontalité. Même si on doit aussi être dans des verticalités métiers, ou de statut (indépendants, agences), soit justement celle dédiée au monde public. Il faut être bien conscient que ce dernier est lui-même subdivisé : les dimensions territoriales, les agences d'État, les ministères, les collectivités, les entreprises publiques, les syndicats mixtes ou même la Commission européenne, qui est une autre dimension. Tous ont des points communs verticaux, mais aussi des enjeux horizontaux. Nous travaillons beaucoup sur ces enjeux horizontaux, ce partage de compétences. En termes de pratiques, je pense qu'on peut avoir des singularités, en effet, sur la finalité (« ce pourquoi on est là », « nos utilités »), mais, en revanche, sur les nouvelles tendances, l'impact de l'IA, les pratiques en matière d'intranet ou autres : on a plein de choses à se raconter horizontalement.
Point commun : Sur la lutte contre les infox ?
Assaël Adary : Exactement, pour la vérification des faits comme pour les enjeux d'éthique de notre métier, cette lutte est commune. En tout cas, il ne faut pas avoir en tête que les communicants du monde privé ne se questionnent pas sur l'éthique, ou sur les enjeux environnementaux de leurs pratiques.
Point commun : Bien sûr. C'est ce qui va nous lier. Est-ce que l’on pourrait, vous qui connaissez très bien tout ce domaine professionnel, en faire une forme de cartographie ? C'est quoi la communication ? Ça commence où et ça finit où ?
Assaël Adary : Parfois, en étant un peu provocateur, je reprends ce que dit Dominique Wolton, je la fais commencer du côté du journalisme ! Ce qui n’est pas une hérésie si on reprend cette idée que l'information est informe et que la mettre en forme, en pensant à une audience dans le cadre d'une ligne éditoriale, c'est déjà communiquer ! Le journaliste communique parce qu'il a une ligne éditoriale, une audience et donc il a le souci que son contenu soit reçu, compris par elle. Même si cette idée bouscule un peu, c'est déjà de la communication.
Pour moi, la cartographie de la communication est très, très large. Elle inclut évidemment la publicité. D'ailleurs, dans le Communicator (1), il y a enfin un chapitre sur la publicité (c'est la première fois depuis 1992 !). Et puis cela va jusqu'à des enjeux d'influence. Vous voyez, peut-être que la bascule, le point ultime est là. Il y a des débats en ce moment sur les affaires publiques, les lobbies. Est-ce que c'est encore de la communication ? Moi, je ne pense pas. Néanmoins, il y a de plus en plus de directions de la communication qui se saisissent de ce sujet ; dans le monde privé, mais aussi dans le monde public. Par exemple, la dircom de France Travail a aujourd'hui dans son champ de compétences les affaires européennes et les enjeux européens (presque du juridique).
J'aime bien quand on ramène certains enjeux dans le monde de la com et qu'on ne les laisse pas, par exemple, au marketing.
Finalement je dis souvent que, pour les enjeux de marque par exemple (dans le public comme dans le privé), j'aime bien quand on les ramène dans le monde de la com et qu'on ne les laisse pas au marketing. Pour moi, la marque territoriale est un vrai sujet de communicants. Donc, j'ai plutôt une vision extensive de la communication et, après, on pourrait aussi avoir une vision plutôt technique ou par métier en se frottant à d'autres fonctions…
Point commun : Le numérique, par exemple ?
Assaël Adary : Exactement, le numérique. Où finit l'informatique, les DSI, et où commence notre métier ? Mais il y en a un qui est encore plus célèbre, la fameuse marque employeur. Et ça aussi, pour les territoires, c'est un énorme sujet. On voit apparaître de vraies marques employeur territoriales. Et là : où commencent les ressources humaines et où commence la com ? Comme je suis un peu militant de la fonction com, j'ai plutôt tendance à pousser un peu les feux en disant : « En tout cas, on doit coopérer, mais plutôt avec le leadership à la fonction com. » De cette façon, on peut avoir une vision des sujets de com stratégique, puis, après, des considérations techniques ; cela crée un cadre que je pense intéressant de mettre en avant. La com interne, c'est encore malheureusement un débat. Je ne sais pas pour la compublique, mais dans le monde privé on recommence à avoir des dirigeants qui ont envie de mettre la com interne sous la responsabilité des ressources humaines.
Vers une promesse employeur
C’est le cabinet Occurrence, dirigé par Assaël Adary, qui a mené pour Cap’Com à deux reprises une étude sur la marque employeur, devenue en 2025 « la promesse employeur » et qui a été présentée aux Rencontres nationales de la communication interne, à Montreuil en avril dernier.
Point commun : On sent chez vous ce souci professionnel, cette exigence, cette même réflexion au sein de votre cabinet Occurrence, dans vos publications ou dans votre investissement dans l'Association nationale des communicants, etc. Quelle est cette fibre, ce sens du commun qui vous positionne et vous rend proche, y compris de nous, les communicants publics ?
Assaël Adary : Il y a un chapitre dans le Communicator (1) sur le sujet, car j’apprécie de revenir aux grands théoriciens de la com. Il y a un modèle théorique qui est apparu en 1959, celui de Riley et Riley (voir le schéma 2 page 71 dans l'article de Dominique Picard), qui est pour moi hyper contemporain... Il y a un émetteur qui encode une information (ça veut dire lui donner une forme), il y a des récepteurs qui décodent cette information. Tout ce petit monde est là, il y a du bruit partout, des intentions fragmentées et plein d'autres choses, mais finalement, à la base, l'ossature de nos métiers est la même. Ensuite, on ne les met pas au service de la même cause, ni du même sujet. C'est comme si on avait une chair un peu différente, mais, quand même, une colonne vertébrale, un squelette, assez similaires !
C'est comme si on avait une chair un peu différente, mais une colonne vertébrale, un squelette assez similaires !
Ensuite, ce qui aujourd'hui, je pense, nous sépare, c'est cet enjeu d'intérêt général, de bien commun. En même temps, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a absolument aucun sens de l’intérêt général dans le monde privé…
Point commun : L'entreprise vit selon des règles qui sont définies ailleurs que dans l'entreprise. Par exemple, le droit du travail ou les règles sanitaires, qui sont définis par la loi et la loi, c'est la République.
Assaël Adary : Oui, complètement. Mais en revanche, si on regarde le contrat social que certaines entreprises fabriquent y compris des PME (citons Léa Nature par exemple à La Rochelle), elles offrent beaucoup d’amortisseurs qui vont souvent bien au-delà de la loi. Dans les grandes entreprises, il y a des amortisseurs sociaux tout au long de la vie. Par exemple, certaines entreprises mettent en place des systèmes pour les salariés aidants.
Point commun : Des entreprises impliquées dans la RSE, des entreprises citoyennes ?
Assaël Adary : Le mot citoyen est intéressant. Il faut regarder les premières lignes du premier Communicator qui est sorti en 1992. C'était justement un mot des cinq premières lignes de l'introduction : l'entreprise a des droits et des devoirs face à la société, face à la cité, etc. C'est ce que disait Marie-Hélène Westphalen, la créatrice du Communicator (1). Déjà, à ce moment-là, c’était un enjeu pour notre métier… il y a trente ans. Ce qui se passe dans l'entreprise, ce que fait l'entreprise, a une dimension sociale, a un impact sociétal.
Point commun : Et les communicants le répercutent, ils l'expliquent, ils le développent ?
Assaël Adary : Oui, et même, parfois, les communicants peuvent être une force motrice. Pour moi, les communicants sont et vont de plus en plus être la vigie de leur organisation. Vraiment. Ils vont être en haut du mât et ils vont dire : « Là, il y a des icebergs, là, il y a un danger, là, il y a la terre, etc. » De plus en plus, ils vont développer cette capacité de décryptage, cette fonction d'analyse des changements de société, des évolutions de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait dans l'organisation. Si on regarde les choses en face, ils sont tous dans leur silo ! Celui ou celle qui a une vision transversale, qui a a priori une sensibilité aux sciences humaines, aux sciences sociales, c'est le ou la communicante, dans le monde public comme dans le monde privé.
Un deuxième point qui va de pair avec le rôle de vigie : la fonction du courage dans l'organisation.
En fait, je suis convaincu que, s'il y avait eu un ou une communicante sur le Titanic, il ou elle aurait vu les icebergs, le potentiel danger environnant, loin des logiques internes. Et là, c'est un deuxième point qui va de pair avec le rôle de vigie : la fonction du courage dans l'organisation.
Point commun : Le courage du communicant ?
Assaël Adary : Oui, je pense que le communicant, c'est celui qui est autorisé dans l'organisation à aller tirer la manche de son maire, de son élu ou de son patron, de son P-DG en lui disant : « Si, si, moi, j'ai vu, j'ai entendu des choses, j'écoute les réseaux sociaux, j’entends l’opinion, et mes petits capteurs me remontent des infos. Et je vous dis que là, il y a des icebergs. Donc, s'il vous plaît ; agissez ! » Après, on est entendu ou pas.
Point commun : Est-ce qu'au contraire, dans le public, le communicant ne serait pas moins écouté, bien plus encadré ?
Assaël Adary : Probablement, mais, vous savez, ma grand-mère me disait : « On a une bouche et deux oreilles, on devrait écouter deux fois plus qu'on ne parle. » Je pense que le champ de la com va se rééquilibrer de plus en plus entre sa force d'émission et sa force d'écoute. Est-ce que nous ne sommes que le bras armé de la parole ? Je vais reprendre ce que dit mon collègue, Jérôme Fourquet : nous sommes face à une archipélisation de la société et naviguer dans les archipels, c'est assez dangereux. De plus, notre société se radicalise, donc on a peur de prendre des flèches à droite, à gauche. Pour cette navigation à haut risque, les maires, les élus, les directions générales vont avoir de plus en plus besoin d'un GPS d'opinion (il peut y avoir des GPS politiques, mais c’est autre chose).
C'est le polyglotte de l'organisation dans le sens où il parle le langage de ses élus, de son institution, des habitants.
Je pense que là, il y a une opportunité majeure pour le communicant qui, justement, doit ramener sa fraise. En fait, le communicant, c'est le polyglotte de l'organisation dans le sens où il parle le langage de ses élus, de son institution, des habitants…
Point commun : Et des services aussi.
Assaël Adary : Oui. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je dis vraiment polyglotte et pas juste bilingue. Polyglotte, c'est ça la force ! Le communicant parle de nombreuses langues et son job, c'est de traduire tout ça aux administrés, aux entreprises sur le territoire, aux associations. À ce sujet, j'ai un exemple parfait, celui de Caroline Fontaine qui a été la dircom de la Mairie de Paris assez longtemps. Son diplôme de base, c'était traductrice, notamment en russe, elle était interprète pour Mikhaïl Gorbatchev quand il venait. Quand je décris son métier, je dis qu’elle continue à être traductrice. « Elle traduisait le “Anne Hidalgo” aux Parisiens. » Pour bien traduire, il faut connaître la langue de l'autre. C'est là que l’on retrouve l’impératif d’écoute. Si je n'écoute pas, je ne vais pas traduire grand-chose.
L’essentiel, c'est donc cette capacité d'écoute, puis cette capacité de courage. On peut même faire un parallèle avec le bouffon du roi. Il disait des vérités très crues, sous l'angle de la blague ou de la fable. Mais c'était le seul à qui on ne coupait pas la tête.
Être celui qui va cartographier les choses, qui va aider à la navigation d'opinion.
Parfois j’utilise le néologisme de « premiumisation » de la fonction com, dans le public comme dans le privé. C’est-à-dire arriver à se convaincre que je ne suis pas que la force exécutante de la parole, je suis aussi celui qui va cartographier les choses, qui va aider à la navigation d'opinion. Face à ceux qui, chacun dans leur coin, s’occupent des navigations économiques, politiques, techniques, etc.
Point commun : Les communicants anticipent les jeux d’acteurs ?
Assaël Adary : Exactement. Je vais vous donner un exemple. Depuis quelques mois, la direction de la SNCF s'est réorganisée et notamment a mis au cœur de la direction de la com, dirigée par Stéphanie Rismont, un pôle planning stratégique. Au sein de la communication, c’est une fonction d'écoute, de compréhension, d’analyse, de décryptage pour que les collègues transforment leurs outils, leurs messages et s’adaptent rapidement. Je suis convaincu que c'est une vraie tendance. Nous entrons dans un monde tellement incertain, compliqué, complexe, ambigu, volatil même – avec des revirements d'opinions extrêmement puissants, avec des propagations de fausses nouvelles –, qu’il faut calibrer sa com en permanence.
Point commun : Vous parliez en introduction de différences de finalités de la com. Est-ce que cette vision va au-delà ?
Assaël Adary : C'est sûr que, dans une entreprise, on sert plutôt un intérêt particulier qu'un intérêt général. Mais pour moi, ce n'est pas forcément opposé à un intérêt collectif ou au bien commun. Il se passe tellement de choses dans une entreprise. Je connais beaucoup de communicants, par exemple, dans les grands groupes, qui ont eu la chance de faire leurs deux, trois dernières années complètes avant la retraite en mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'ils sont détachés dans la vie associative. On ne se rend pas compte du bataillon de communicants que cela représente, avec l'allongement de la période active. Je suis certain que l'on va avoir de plus en plus ce genre de porosités avec l’environnement social. Et pour les associations qui reçoivent ces compétences, ce n'est pas anodin. Et avec derrière aussi un vrai problème de renouvellement, parce que l'engagement dans un bénévolat à l'ancienne est de moins en moins pratiqué. Il faut mettre en avant les solidarités, les parrainages, les tutorats, dans nos métiers particulièrement. Et si possible de façon transversale pour que les finalités se rejoignent !
Point commun : Vous semblez optimiste, mais les études que vous menez montrent en parallèle des tendances moins enthousiasmantes.
Assaël Adary : C’est le cas pour la responsabilité sociale et environnementale. Il y a un contrecoup, oui. Il y a là, malheureusement, un point qui peut faire converger le privé et le public au sens très large du terme. Dans toutes les études que l'on mène, vis-à-vis du citoyen et du consommateur, pour les entreprises ou pour le monde public, il y a, en France (même en Europe et dans le monde), une forme de lassitude, de fatigue RSE. Mais cela concerne les très grandes causes. Pour ma part, je vois un autre chemin, vers une nouvelle RSE.
Je vois un autre chemin, vers une nouvelle RSE que j'appelle la RSE de proximité.
D'ailleurs, Denis Maillard, qu'on a vu hier sur scène [au Spot Festival – ndlr], a écrit un texte pour la Fondation Jean-Jaurès, qui est sorti il y a un mois : « La RSE, ça dégage ? ». Là, on se retrouve, entreprise et monde public, sur la RSE, sur ce que j'appelle la RSE du quotidien ou la RSE de proximité. Par exemple, si je suis un salarié de terrain chez Enedis, et qu’on me dit que je vais sauver des ours polaires, ce n'est plus entendable. Nous mesurons à ce sujet une fatigue, une grosse fatigue. En revanche, si, dans mon métier, je vais reconnecter, je vais remettre l'électricité à mon voisin, à l'école ou à la caserne de pompiers, c'est ce que j'appelle la RSE de proximité.
Point commun : On se rapproche du territoire...
Assaël Adary : Exactement. Et donc, quand je regarde ce que fait Enedis, dont la dircom Catherine Lescure est aussi la directrice RSE, qui est devenue une entreprise à mission, on est concrètement sur l'intérêt général, même si on est dans un monde avec des enjeux financiers indéniables. C'est pareil pour la marque employeur. Occurrence a fait une étude auprès de 13 000 jeunes diplômés d'écoles ou d'universités ou seulement du bac. Sur 19 critères-arguments pour choisir leur futur poste, ils positionnent la RSE à la 15e place. En revanche, ils demandent un environnement de travail sain, une égalité des chances, de salaire, un management non toxique… ce que j'appelle à nouveau la RSE du quotidien. Et je pense que, là-dessus, à nouveau, com privée, com publique se rejoignent sur ces enjeux. L'enjeu, c'est : « Comment tu changes mon quotidien ? Comment tu améliores mon quotidien ? »
Point commun : Est-ce que ces changements ont été mis en lumière dans la dernière édition du Communicator ?
Assaël Adary : Oui. Nous avons trois nouveaux chapitres : la publicité, l'influence (qu'on a sortie des relations publiques) et la com responsable (qui était avant un sous-chapitre). Évidemment, comme pour chaque édition, on est entre 60-70 % de nouveaux contenus, et donc, comme à chaque fois, on se dit : « Est-ce qu’on ne va pas trop changer ? » En fait, en trois ans, l’ouvrage ne bouge pas sur les fondamentaux. Mais les cas pratiques, les usages, changent énormément.
La compublique n'est pas un « truc à part », elle touche tous les aspects de nos métiers.
On peut dire également que certaines lignes de force n’ont pas de chapitre, il y a trois sujets qui reviennent en pointillé dans tout le Communicator (1) :
- c'est l'intelligence artificielle, dont on n'a pas voulu faire un chapitre, mais que l’on a traitée dans tous les chapitres ;
- c'est la dimension RSE et la com responsable, qui se retrouvent dans la pub, dans l'influence ou dans la communication interne ;
- et le troisième, qui est une ligne directrice, c'est la communication publique.
Pour elle, on n'a pas voulu tout redécliner dans un chapitre (Qu’est-ce que la publicité, la com interne, le marketing ou la com de crise en mode public ?). Nous avons un devoir d’horizontalité, donc on l'a répartie dans des cas pratiques dans l’ensemble du Communicator... La compublique au sens large (pas seulement territoriale) se retrouve vraiment partout. En fait, c'est une sorte de grande tranche napolitaine et c'est comme ça qu'on lui rend le mieux justice, en permettant de percevoir le fait que ce n'est pas « un truc à part ». La compublique touche tous les aspects de nos métiers.
(1) Communicator, 10e édition, 680 pages, paru en juin 2025 chez Dunod.