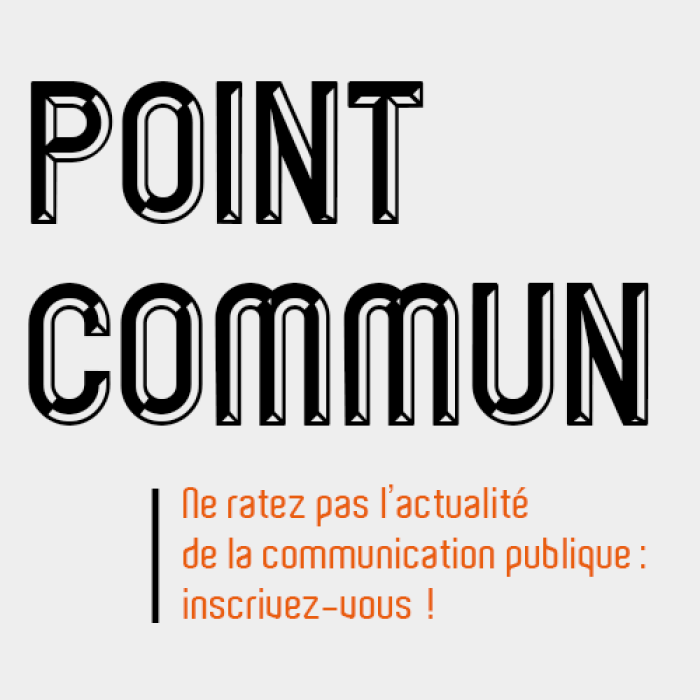Faire revenir les expatriés, un chemin semé de croyances et d’embûches
« Faire revenir »… Faisons donc un focus sur l’un des enjeux des stratégies d’attractivité. Pourtant peu visible sur les sites de marketing territorial, cet objectif semble néanmoins être dans toutes les têtes. Pour autant, l’écueil serait de s’appuyer sur des idées reçues, notamment celles qui consistent à croire que tous les expatriés veulent revenir sur leurs terres et que ce sera très facile avec eux, car ils auraient leurs racines dans la peau. La réalité est sans doute un rien plus complexe.
Par Marc Thébault, consultant en attractivité des territoires, ancien responsable de la mission attractivité de Caen-la-Mer.

La période post-Covid a ouvert beaucoup d’espoirs pour les territoires en recherche de nouveaux habitants : il était annoncé que tout le monde allait fuir les grandes villes ! Les faits ont montré que, contre toute attente, pas d’exode des urbains vers la province à constater. Puis, une cible particulière a émergé de cette période pour nombre de chargés d’attractivité : les expatriés ! D’où le souhait de, désormais, faire passer à l’acte celles et ceux qui, on le croit, sont à deux doigts de revenir vers leur territoire d’origine. Et sans besoin d’en faire des tonnes : elles et ils seraient par essence absolument convaincus. Une sacrée économie d’énergie donc, et des résultats quasi garantis. Pourtant, les choses ne sont pas si simples. Mais d’abord un peu de documentation...
Le podcast « Ciao Paris », animé par Valérie Bauhain, a mis à l’honneur Pauline Rochart, sociologue, parisienne pendant douze ans et revenue dans sa ville d’origine, Dunkerque. De cette expérience, elle a voulu tirer quelques analyses et a recueilli une trentaine de témoignages d’autres « revenus » dans son livre Ceux qui reviennent, paru aux éditions Payot. Les deux épisodes du podcast « Ciao Paris » sont à retrouver sous ces liens et je vous engage fortement à prendre le temps de les écouter : partie 1 et partie 2. Par le livre ou le podcast, vous verrez que « retour au pays » peut rimer avec « retour en arrière » et que celles et ceux qui sont restés ne sont pas forcément enthousiastes à l’idée de voir revenir les personnes qui ont tenté leur aventure dans une grande métropole ou à Paris. Mais vous noterez aussi que « les données de l’Insee le confirment : près d’un tiers des Parisiens qui quittent la capitale retournent vivre dans leur département d’origine ».
En parallèle, j’ai été attentif aux initiatives d’Attitude Manche sur ce sujet et je vous invite à découvrir les coulisses de leurs initiatives exposées sur le site « Laou ». J’ai aussi lu un autre article de ce site, consacré à un échange avec Pauline Rochart et dans lequel Aurore Thibaud (cofondatrice de « Laou ») présente plusieurs conseils pour mieux toucher les expatriés.
Tout se passe donc comme si les territoires souhaitaient vraiment le retour de leurs expatriés, mais sans prendre la peine de forger un circuit qui leur serait dédié, avec des arguments et des services spécifiques.
J’ai aussi recherché, surtout sur la carte des marques d’attractivité hébergée sur My Observatoire, les sites qui afficheraient un onglet « revenir » (ou un synonyme) : j’ai fait chou blanc, en dehors de Moselle Sans Limite (MOSL), qui propose sur son site ces trois entrées : Viens – Reste – Reviens. Donc, visiblement, très peu d’entrées réservées à cette catégorie de cibles. Elle doit donc se contenter de recevoir les mêmes argumentaires que celles et ceux qui ne connaissent pas le territoire, se taper la liste du patrimoine, forcément exceptionnel, qu’elle connaît pourtant par cœur (merci les visites scolaires !) et toute l’histoire du territoire ! Mais peut-être suis-je passé à côté : je suis donc preneur d’exemples si vous en connaissez. Ainsi, tout se passe donc comme si les territoires souhaitaient vraiment le retour de leurs expats, mais sans prendre la peine de forger un circuit qui leur serait dédié, avec des arguments et des services spécifiques. En somme, adapter leur discours et leur promotion à ces cibles particulières. Ce qui est pourtant l’un des fondements du marketing.
De tout cela, me viennent quelques réflexions que je vais partager avec vous, notamment sur quatre freins au retour, en tous les cas sur des manques à combler pour peaufiner une stratégie résolument sur mesure.
1. Une méconnaissance du territoire d’aujourd’hui
Et si, bien que nous pensions souvent que les expatriés savent déjà tout du territoire, la réalité montrait qu’ils ne sont peut-être pas au fait de l’actualité locale, qu’il s’agisse de réalisations récentes, de projets en cours, de nouveaux services ou qu’il s’agisse d’opportunités d’emploi et de carrière ?
Même si ces expats reviennent régulièrement sur leur territoire d’origine – pour des vacances, pour revoir famille ou amis, pour des mariages (ou des enterrements), parfois aussi pour voter (je n’ai pas connaissance d’études sur ce sujet mais il semble que beaucoup n’aient pas changé de bureau de vote. Acte manqué, comme dirait mon psy ?) –, rien ne dit que cela suffise pour les « mettre à jour ». Certes, on doit pouvoir compter sur celles et ceux qui sont restés – et qui deviennent donc des relais d’information en puissance – en croisant les doigts pour que les collègues de la communication aient bien accompli leur travail de diffusion de l’information publique locale.
Comment la pallier ?
Faire en sorte que, notamment en ce qui concerne les opportunités d’emploi et de carrière, on multiplie les occasions de rapprocher monde économique et population. Deux exemples sur cette thématique, des actions pérennes de deux territoires, le Doubs avec « Made in chez nous » et Angers avec « Made in Angers » (et il y en a sans doute d’autres). Il s’agit, pour ces deux cas, d’ouvrir les entreprises au local (parfois même aux touristes), souvent sous la forme de visites régulières d’entreprises, pendant une période donnée, et ainsi faire en sorte que le monde du travail local soit mieux connu. De quoi renforcer l’information des locaux pour qu’ils puissent la faire remonter à leurs expats, mais aussi, en anticipant, renforcer l’information des futurs expats eux-mêmes en les informant massivement avant qu’ils ne partent. Dans mon dernier poste, j’ai été abasourdi par la méconnaissance des professeurs de grandes écoles locales quant aux opportunités professionnelles sur place. C’est donc un sacré chantier à ouvrir.
2. Des décalages entre les souvenirs et la nouvelle réalité
Ici, on va plus être du côté « psychologique », mais il vaut la peine qu’on s’y attarde. Rappel basique : un territoire vit, donc il évolue, il change, il se métamorphose, peu ou prou. Pour autant, les souvenirs penchent parfois vers le nostalgique ou vers l’idéalisation et, lors d’un retour sur place, on va peut-être rechercher ces paysages ou ces lieux qui incarnent des souvenirs d’enfance. S’ils ont été remplacés ou supprimés, la déception peut être terrible et le « c’était mieux avant » risque de surgir. Comme le chante Orelsan (pardon pour mes références si liées à mon propre territoire) : « À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie d'mon passé » (extrait de « Dans ma ville on traîne »). Pourtant, comme l’écrit Pauline Rochart dans le livre cité plus haut : « Ceux qui sont revenus ne se sentent pas particulièrement chauvins ou fiers de leur région, mais ils ressentent – pour reprendre les mots de l’écrivain Nicolas Mathieu – “l’effroyable douceur d’appartenir” à quelque part. » Tout n’est donc pas perdu.
Il est question de démontrer que la qualité de la vie locale est toujours présente, garantie par les valeurs permanentes du territoire qui, au fond, est resté lui-même.
Comment les pallier ?
Dans son livre Se tenir quelque part sur la Terre. Comment parler des lieux qu’on aime (aux éditions Premier Parallèle), Joëlle Zask écrit : « Retourner, ce n’est donc pas revenir en arrière. Le sentiment qu’il est impossible de revenir sur ses pas et de retrouver ce qu’on a quitté s’appelle la nostalgie. C’est une émotion triste. Or elle n’est pas nécessaire. Nous pouvons au contraire nous réjouir de savoir que les lieux que nous avons quittés ne seront plus jamais les mêmes, étant restés vivants. »
Ici, il s’agit sans doute de donner un nouvel élan aux divers réseaux mis en place par les territoires, qu’il s’agisse « d’ambassadeurs » ou de « partenaires », surtout à leurs membres de l’extérieur qui forment une « diaspora ». C’est peut-être en diffusant les projets, les réalisations, et surtout leurs fondements, que l’on permettra à cette diaspora de suivre et de comprendre, même de loin, l’évolution du territoire. Et ainsi, peut-être, leur épargner des déconvenues à l’occasion de leur retour, voire leur permettre de se forger de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques sociales. Le petit bar où ils allaient adolescents a disparu ? D’accord, mais un nouveau lieu est ouvert depuis quelque temps et il offre certainement autant d’atouts et de convivialité, voire plus, que l’ancien. En somme, il est question de démontrer que la qualité de la vie locale est toujours présente, garantie par les valeurs permanentes du territoire qui, au fond, est resté lui-même.
3. Un sentiment de déclassement
Je l’évoquais au début du texte : le retour à sa base peut avoir le goût de la régression, du retour en arrière. Après tout, on « monte » à la capitale mais on « descend » en province. Peut-être même la saveur amère de l’échec et, une fois de plus, le livre de Pauline Rochart sera éclairant sur ces aspects. Par exemple, à l’occasion de recherches d’emplois locaux, nombreux sont celles et ceux qui se sont vus étiquetés comme « surqualifiés » (et je ne parle même pas du salaire et du décalage entre ceux d’une grande métropole et ceux de territoires plus restreints), car il est trop souvent considéré qu’une « belle » expérience professionnelle dans un grand pôle urbain ne trouvera jamais d’équivalence dans une ville petite ou moyenne. Ainsi, les recruteurs peuvent hésiter parfois à confier un emploi à celles et ceux qui, à leurs yeux, ne se satisferont pas longtemps d’un poste plus modeste que leur ancien emploi. Ou qui, peuvent-ils le craindre, pourraient constituer un risque pour le management actuel en présupposant des ambitions sans limites.
Comment le pallier ?
Il ne s’agit sans doute pas d’une recette miracle, mais peut-être faut-il compter sur le désir des expatriés de revenir aux sources pour avoir professionnellement une vraie utilité, un réel impact. Et un impact visible par eux et par le territoire. L’étude de « Paris je te quitte » de début 2025 le démontrait assez bien : « Ils [les Franciliens – ndlr] ont besoin de vivre dans un territoire dans lequel ils vont pouvoir s’épanouir pour 50 % d’entre eux, en phase avec leurs valeurs mais où ils pourront aussi – et surtout – avoir un impact tangible, qui a tendance à s’estomper dans les grandes métropoles, qui plus est à Paris. » Ce qui se vérifie également pour les expatriés dont un certain nombre, en quête de sens professionnel, souhaitent revenir dans un monde aux dimensions plus « humaines ». Cette piste étant à mettre en lien avec la suivante.
4. Ne pas (re)trouver sa place
Parce que le territoire a changé, parce que des repères ont disparu, parce que celles et ceux qui sont restés peuvent craindre ces retours en les considérant comme des menaces pour eux-mêmes (Pauline Rochart évoque, en référence aux ouvrages de Michel Lussault, la « lutte des places »), un retour n’est pas forcément placé sous le signe du succès. N’est pas Gigi l’Amoroso qui veut (« Ici, ici tu es chez toi Gigi... Ici tu es le roi. » Avez-vous la réf ?), encore moins l’enfant prodigue. La vie locale a continué, évidemment, et ce malgré les absences.
Il sera question de rassurer les expatriés en leur déclarant clairement qu’ils ont bien leur place ici, qu’ils seront bienvenus et utiles.
Comment le pallier ?
Parmi les raisons qui sous-tendent un retour au pays, il est souvent remarqué un besoin de liens sociaux, un besoin d’ancrage, voire une quête identitaire, en recherchant à redonner corps au « sentiment d’appartenance ».
Si je retourne du côté de l’étude de « Paris je te quitte » citée plus haut, il est précisé : « À Paris, on est comme une fourmi dans une fourmilière. C’est excitant quand on démarre dans la vie, avec une insatiable soif de découverte. Mais lorsqu’on avance, qu’on a lancé sa carrière, posé les bases de sa vie, les priorités changent. Cette découverte peut devenir… un anonymat. Difficile quand on recherche du sens. Il est beaucoup plus difficile de sentir qu’on a de l’impact dans une grande ville que dans une petite, et les besoins sont aussi moins importants, lisibles, évidents. Les “petits” territoires ont besoin d’utilité, de forces vives, et peuvent accorder une vraie attention à accueillir et accompagner les nouveaux arrivants. De quoi faire sens et laisser une trace ! »
Il s’agit de pouvoir démontrer que les aspirations de certaines catégories de population peuvent trouver, sur tel ou tel territoire, le terreau de leur accomplissement car elles entrent en résonance avec les attentes mêmes de ces territoires. Ou quand la raison d’être d’un territoire correspond à celle de celles et ceux qui veulent revenir. D’où l’importance de présenter et rappeler cette raison d’être territoriale, ou le « terrikigaï », dirait la Fabrique Spinoza.
Ainsi, pour les expatriés, il sera question de les rassurer en leur déclarant clairement qu’ils ont bien leur place ici, qu’ils seront bienvenus et utiles !
Sur cette thématique, et j’ai bien l’intention d’en faire un billet spécifique, je recommande la lecture du numéro 549 du 1 Hebdo (11 juin 2025), dont le sujet principal est « Où est-on chez soi ? ». Mais je dévoile néanmoins ces propos de Pauline Rochart : « “Faire société”, c’est d’abord faire, et c’est dans la matérialité des lieux, des pratiques et des objets que se joue le fameux “vivre ensemble”. »
Il n’est pas question de stigmatiser ces départs ou de les empêcher. Il est plutôt question de semer les graines utiles pour que l’attachement soit suffisamment fort afin qu’un retour soit, un jour, envisagé.
En conclusion, trois choses
D’abord, il ne sera pas vain de rechercher les raisons des départs. Parfois il ne s’agit pas de choix, mais de contraintes, par exemple pour suivre un conjoint, pour poursuivre des études ou, bien sûr, pour un emploi. Comme le dit Pauline Rochart dans le 1 Hebdo (références ci-dessus) : « Il y a la mobilité choisie et la mobilité subie. » Elle ajoute également au sujet de ceux qui ont fait le choix de la mobilité : « L’idée pour eux était […] de rejoindre des lieux où se présentent davantage d’opportunités. Ce qui est énoncé […] c’est le désir de partir pour s’émanciper en côtoyant des gens ayant des mentalités différentes, en accédant à une forme d’anonymat. » Autant de chantiers à ouvrir pour les territoires, mais surtout à ouvrir avant que les départs se fassent peut-être. Mais il n’est pas question de stigmatiser ces départs ou de les empêcher. Il est plutôt question de semer les graines utiles pour que l’attachement soit suffisamment fort afin qu’un retour soit, un jour, envisagé. Et sur cet attachement (vous connaissez mon penchant pour cette thématique), je ne peux que citer de nouveau Joëlle Zask : « S’il fallait utiliser une métaphore pour signifier ce type de situation, je préférerais celle du lestage à celle, souvent utilisée en matière d’“attachement” aux lieux, de l’ancrage. Car l’ancre constitue un point fixe pour l’embarcation qui a mouillé, tandis que le lest permet de se déplacer sans flotter ou s’envoler. »
Pour terminer, je me dois de partager avec vous ces paroles de la chanson « Je tiens d’elle » de Bernard Lavilliers et Terrenoire :
« Il faudra que je parte, mais promis je reviens
Poser ma rose fière sur la terre des anciens
Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins
Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un. »
Ensuite, il sera tout aussi utile d’analyser les raisons d’un retour. Pauline Rochart évoque la parentalité comme l’une des raisons majeures, avec la recherche de l’aide de la famille restée sur place, notamment parents ou grands-parents. Là encore, peut-être une carte à jouer pour les territoires dans la gamme de services à offrir à de jeunes familles. Bruno Walter, pour un article de « Brief » (n° 104, avril 2023, et titré « Attractivité résidentielle : la nouvelle donne »), pose cette question à Christophe Alaux, responsable de la chaire attractivité et nouveau marketing territorial : « Après avoir souvent privilégié l’exogène, les territoires ne sont-ils pas en train de s’intéresser plutôt à l’endogène, à la qualité, pour fixer les populations ? » La réponse est sans équivoque : « C’est une tendance qui s’est accélérée après la crise du Covid. Aucun territoire n’aborde la question de l’attractivité sans intégrer les questions environnementales. C’est aussi un travail sur les politiques publiques. Un élu lyonnais avait résumé cela en disant : “L’attractivité commence par les crèches municipales”. »
Enfin, il sera nécessaire de prévoir des accompagnements personnalisés, adaptés à ces cibles si spécifiques. Nombre de services d’accueil pour nouveaux arrivants élargissent leurs missions. D’ailleurs certains commencent à se nommer « service hospitalité ». Formulons le vœu que cette hospitalité s’applique également aux expatriés car, on vient de le voir, ils demandent aussi qu’on s’occupe d’eux.
Illustration : photo d'Ali Aksu sur Unsplash.