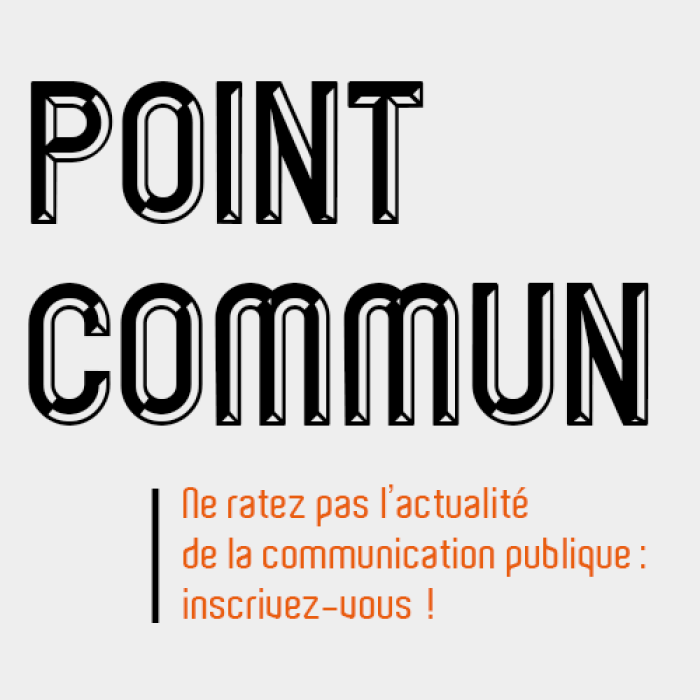Christophe Béchu : « La communication publique doit avant tout engager »
À quelques semaines d'un Forum qui fera le pont entre récit et accompagnement des transitions, Point commun donne la parole à Christophe Béchu, maire d’Angers et ancien ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C’est un homme de convictions qui s’exprime, sur les enjeux nationaux, sur le rôle de la communication publique et sur les défis et obstacles des territoires dès lors qu'il s'agit d'accompagner des mesures nécessaires et délicates pour tous.
Point commun : Vous avez dirigé un ministère doublement en rapport avec la communication publique (qui accompagne les transitions et les territoires). Quelles leçons en avez-vous tirées de ce point de vue ?
Christophe Béchu : D’abord, il faut rappeler que les phénomènes de dérèglement climatique s’accélèrent sous nos yeux : incendies, inondations, sécheresses, érosion du littoral... La science est sans appel : nous consommons trop vite des ressources limitées, la biodiversité s’effondre et ce sont nos activités humaines qui sont à l’origine de ce bouleversement climatique sans précédent. Ce constat nous oblige à agir pour enrayer ce changement tout en nous adaptant pour faire face aux réalités du monde de demain. Nous devons donc impérativement refuser la démagogie, débusquer les impostures et porter un discours de responsabilité. C’est le leitmotiv pour toute communication sur le sujet. Et plus encore, la communication doit nous aider à anéantir les « fake news ».
Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, c’est le ministère de toutes les transformations. C’est l’endroit où l’on bâtit l’avenir, où l’on protège les Français, où l’on s’adapte en permanence aux évolutions du monde. C’est un lieu dans lequel s’exerce une perpétuelle tension entre l’urgence et la nécessité de préparer le long terme. C’est donc sur ce rythme que communique le ministère, sa direction de la communication, ses administrations. La leçon principale que j’en retire, c’est cette capacité indispensable pour s’adapter à ces deux vitesses.
Point commun : Comment la communication publique peut-elle mieux accompagner les transitions socio-environnementales ?
C. B. : La communication publique a un rôle décisif : elle ne doit pas seulement informer, elle doit avant tout engager. Trop souvent, on réduit la communication à une transmission trop verticale, trop descendante, de messages eux aussi trop techniques. Or, accompagner une transition, c’est avant tout rendre les citoyens acteurs. Cela suppose de présenter des récits de solutions concrètes, de bénéfices partagés et bien sûr de donner la parole à celles et ceux qui vivent la transformation au quotidien : les élus, les associations, les entreprises, les citoyens.
La communication publique doit créer un climat de confiance entre climato-scepticisme et climato-défaitisme. Mais elle doit aussi créer un climat de cohérence : il faut expliquer où nous allons, pourquoi et avec quels moyens, sans masquer les difficultés mais en donnant envie d’avancer. C’est le travail que nous avons engagé par exemple sur la planification écologique en disant « Nous pouvons y arriver, il y a un chemin, il n’est pas simple mais voilà comment nous l’empruntons ».
Point commun : La mise en récit est à la fois attendue pour son accessibilité, sa pédagogie, mais aussi décriée pour ses simplifications voire ses arrangements.
C. B. : C’est une critique que je comprends, évidemment. Tout récit simplifie la réalité mais l’information brute devient vite inaudible, surtout dans un monde où l’information est si dense et délivrée à chaque seconde sur son smartphone. L’enjeu n’est pas d’abandonner le récit, il a bien sûr ses vertus pour faire passer des messages, mais certainement de le rendre plus authentique. Il faut donner des clés de compréhension, présenter des informations qui parlent à tous, proches du quotidien. Le récit, c’est une porte d’entrée, ça ne doit jamais être une fable.
La majorité des citoyens reste profondément attachée à la protection de l’environnement. Le problème, ce n’est pas l’adhésion de fond, c’est la perception du partage des efforts.
Point commun : Les réticences concernant les efforts demandés pour réduire notre impact environnemental (et ses conséquences sur le climat) sont-elles plus fortes aujourd’hui ?
C. B. : Oui, elles se sont accentuées, notamment parce que nous traversons une période de crispations sociales et économiques. Le coût de la vie, les inquiétudes liées à l’emploi, les fractures au sein de notre société : tout cela peut nourrir une forme de lassitude quant à l’écologie. Dans ce contexte, les efforts à fournir pour réussir la transition écologique peuvent être perçus comme des contraintes supplémentaires, voire comme une injonction élitiste. Et les discours qui proposent d’interdire ou de taxer avec une approche extrémiste n’aident pas ! Pourtant, la majorité des citoyens reste profondément attachée à la protection de l’environnement. Le problème, ce n’est pas l’adhésion de fond, c’est la perception du partage des efforts. Chacun peut se dire : si je suis seul à agir, alors à quoi bon ? À l’échelle nationale, c’est la même chose avec les discours qui rappellent que, parce que la France ne représente que 0,8 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, cela ne sert à rien d’agir. Communiquer sur l’impact de chaque action est crucial.
Point commun : Comment y faire face ?
C. B. : En étant justes et concrets. La transition écologique ne devrait jamais être présentée comme une succession de sacrifices, car c’est faux. L’écologie, c’est un projet collectif qui améliore la qualité de vie. L’adaptation au changement climatique, sujet que j’ai contribué à mettre dans le débat public comme ministre, malgré les critiques, c’est en réalité aussi une lutte pour la préservation de nos paysages, de nos traditions, de nos savoir-faire.
Nous devons également redonner du sens à notre combat contre le réchauffement climatique. Cela devient urgent car, lorsque nous n’avançons pas dans cette bataille, nous reculons. Les communicants publics doivent accompagner cela, mais jamais la communication ne remplacera une action crédible et cohérente : dire ce qu’on fait, et faire ce qu’on dit.
Point commun : On parle beaucoup d’un contrecoup en matière d’enjeux environnementaux, qui ont quasi disparu des débats. Quelle est la responsabilité des acteurs politiques ?
C. B. : Elle est importante. Je regrette que certains responsables politiques, en la matière, suivent l’agenda électoral plutôt qu’un cap de long terme. La transition écologique est un marathon, pas un sprint. Quand le climat ou la biodiversité disparaissent des débats, ce n’est pas parce qu’ils ne comptent plus mais parce que nous avons collectivement cédé à l’urgence d’autres crises. Le rôle des responsables publics, c’est précisément de maintenir ces enjeux au centre, d’assumer une vision et de la défendre, même quand elle n’est pas immédiatement populaire. Et de rappeler, même dans une période budgétaire compliquée, que le coût de l’inaction est supérieur à celui de l’action.
Point commun : Ces enjeux sont-ils différents à l’échelle locale ? Est-ce que les territoires peuvent incarner les transitions ?
C. B. : Les transitions prennent corps dans les territoires, parce que c’est là que l’on vit, que l’on se déplace, que l’on consomme, que l’on produit. Une collectivité peut montrer très concrètement qu’une alternative est possible : une ville qui développe les transports en commun, une intercommunalité qui accompagne la rénovation énergétique... Ce sont ces expériences locales qui donnent de la chair aux politiques nationales, qui rendent crédibles les objectifs.
À Angers, nous avons mis en place deux chaufferies biomasse. Nous sommes en train de finaliser une convention avec Atos pour récupérer la chaleur fatale de leurs serveurs. Nous avons aussi créé deux nouvelles lignes de tramway, un vrai enjeu pour la décarbonation du secteur du transport. Nous sommes également aux avant-postes sur le sujet de l’adaptation, avec un plan d’adaptation local qui repose sur l’idée que chaque Angevin doit vivre à moins de 300 mètres d’un espace vert.
Et je remarque que les débats et les crispations sur les outils de la transition écologique – zones à faible émission, zéro artificialisation nette, « DPE », remise en cause des agences… – s’opèrent plutôt sur la scène politique nationale que dans les territoires.
Point commun : Quels conseils allez-vous donner aux communicants publics réunis à Angers le 19 novembre en plénière du Forum ?
C. B. : Être communicant public, ce n’est pas vendre une image, ce n’est pas faire de la publicité. C’est d’abord et avant tout servir l’intérêt général. C’est rendre lisible l’action publique. C’est dire ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et surtout ce que cela change concrètement dans la vie des Français. Mais c’est aussi ne pas cacher les difficultés, ne pas travestir les contraintes. Parce que la transparence est la première condition de la confiance.
La communication publique n’est pas un monologue. Elle ne peut plus se limiter à diffuser des messages. Elle doit être un espace de dialogue. Les citoyens ne veulent pas seulement recevoir des informations, ils veulent réagir. Enfin, la communication publique n’a de sens que si elle est incarnée. Une collectivité ne parle pas toute seule : elle s’exprime à travers des élus, des agents, des femmes et des hommes qui assument une mission de service public. C’est le sens du message que je porterai auprès des communicants publics que je me réjouis de retrouver à Angers le 19 novembre !