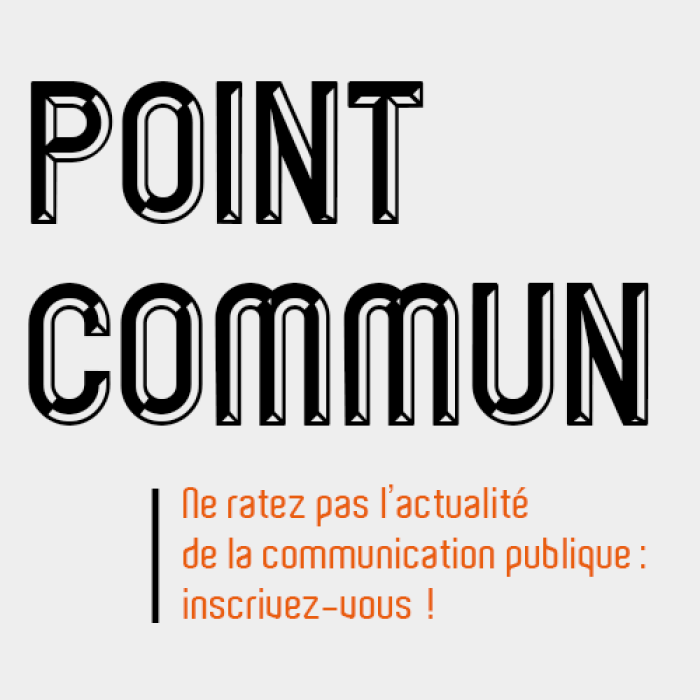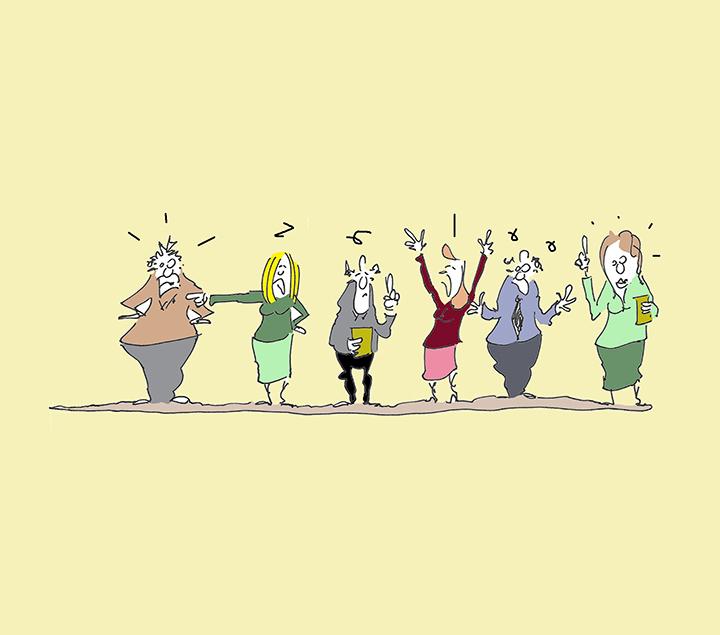
L. 52-1 ou comment la démocratie se tire une balle dans le pied
En France, la régulation des comptes et du financement des campagnes électorales n’a guère plus de trente-cinq ans. À six mois des élections municipales, la réglementation spécifique de l’utilisation des moyens de la collectivité qui s’impose aux maires sortants plonge tous les communicants dans la perplexité et finit par enrayer la bonne marche de l’action publique. Faisons le rêve que la politique au sens le plus noble l’emporte.
Par Christophe Devillers, consultant, ancien directeur adjoint de l'agence d'attractivité Mulhouse Sud Alsace et membre du Comité de pilotage de Cap'Com.

Durant la seconde moitié du XXe siècle, à l’approche des campagnes électorales tout particulièrement, l’observateur de l’ombre ne s’étonnait pas de voir des valises passer de main en main, le donneur comme le receveur étant tous deux intéressés à la transaction, le premier pour des raisons de chiffre d’affaires ultérieur ou d’influence sur la scène locale, nationale ou internationale, le second parce qu’il voulait tout simplement financer un parti ou une élection. C’était « monnaie courante » au sens littéral du terme.
Il fallut attendre 1988 pour que la France se dote enfin de règles sur le financement de la vie politique. Les pays nordiques comme le Danemark ou la Suède l’avaient fait dès 1966. La France y parvint enfin après une trentaine de vaines propositions de loi.
Avec la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et surtout celle du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, la politique française se parait enfin de nouveaux habits plus propres : financement régulier pour les partis et les candidats, maîtrise des dépenses électorales et transparence financière dans les comptes des candidats, des responsables politiques et des formations.
On créa une instance d’approbation des comptes de campagne (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP) et, afin de garantir l’égalité de tous les candidats sur la ligne de départ, on interdit légitimement, à un candidat sortant, l’utilisation des moyens de la collectivité qu’il dirige. Par « moyens de la collectivité », on entend aussi bien mise à disposition gracieuse de biens publics pendant la campagne que recours au personnel communal. Mais c’est surtout l’information et la manière dont elle est diffusée qui font débat et tracent un nouveau terrain de jeu. Car une information partiale dans un support de communication de la collectivité constitue assurément une contribution déguisée. En pareil cas, attaqué par un adversaire devant le juge de l’élection, le candidat sortant devra réintégrer la dépense dans ses comptes de campagne (au risque d’un dépassement éliminatoire) ou écopera d’une inéligibilité dramatique.
Les six mois qui précèdent l’élection deviennent un désert démocratique dans la traversée duquel s’estompe peu à peu le débat public.
Casse-tête des cabinets d’élus, mais nouveau fonds de commerce des avocats du droit public, cette réglementation est devenue une figure imposée des six mois qui précèdent une élection pour les dircoms de collectivités, qui pesaient et soupesaient déjà chaque mot sur le journal municipal et sont désormais confrontés à l’irruption de nouveaux moyens de communication.
C’est ainsi que, depuis les années 1990, face au risque de recours, et par « précaution », on a vu l’action municipale s’étioler en même temps que son explicitation. Tout événement nouveau est devenu suspect : la limite entre « expliquer » et « vanter » étant désormais laissée à l’appréciation du juge. Et les six mois qui précèdent l’élection deviennent un désert démocratique dans la traversée duquel s’estompe peu à peu le débat public. De recours en recours – souvent d’opportunité –, de décision de justice en décision de justice, le champ du dialogue s’est peu à peu réduit comme une peau de chagrin.
À peine, en 2012, le Conseil d’État a-t-il précisé que la tribune d’opposition n’était pas un don de la collectivité à un candidat, qu’on aurait pu assimiler à une aide publique. Sinon, c’en était fait de l’expression minimale de la controverse.
Les communes, entrées dans la fameuse période des six mois de réserve électorale, en sont à s’interroger sur le risque de laisser ou non les commentaires sur leurs réseaux sociaux. L’excès de procédures engagées par les perdants y est évidemment pour beaucoup. Au fond, les acteurs politiques de ces trente dernières années, à force de prudence invoquée par les uns et de contentieux introduit par les autres, ont aseptisé le débat à leur propre détriment. Et la démocratie s’est tiré une balle dans le pied.
Entendons-nous bien : qu’un sortant n’utilise pas les moyens de la collectivité publique qu’il dirige pour pousser ses slogans de campagne est salutaire. Mais faut-il aller jusqu’à juguler la liberté d’expression des citoyens là où ils peuvent le faire facilement et dans la plus grande clarté ? (1)
Que les candidats et leurs équipes de communication s’attachent à privilégier la victoire du choix éclairé dans l’urne plutôt que sur tapis vert.
Dans une société où la règle se glisse dans tous les interstices du quotidien, où on légifère sur tout et surtout sur les détails, la politique gagnerait à rester un espace préservé de la judiciarisation. À défaut, il n’y aura plus de politique.
L’esprit de L.52-1, l'article du Code électoral qui prohibe les campagnes de promotion des réalisations d'une collectivité six mois avant le scrutin, c’était une mise à égalité vertueuse de tous les candidats. Rien de plus. Rien de mieux. Et si on revenait à l’esprit de la loi en faisant juste de la politique, dont Édouard Herriot disait que c’était « parler aux gens » ?
Engageons un programme éthique de « désarmement judiciaire » des élections.
Que les critères pertinents et mesurés de neutralité, de régularité, de continuité, d’antériorité et d’identité de la communication puissent se conjuguer avec un échange régulé, respectueux et vivant des expressions dans leur diversité.
Que les candidats et leurs équipes de communication s’attachent à privilégier la victoire du choix éclairé dans l’urne plutôt que sur tapis vert.
(1) Sans compter le contentieux supplémentaire que cela occasionnera. Lire à ce propos le post de Pierre Renaud sur LinkedIn.