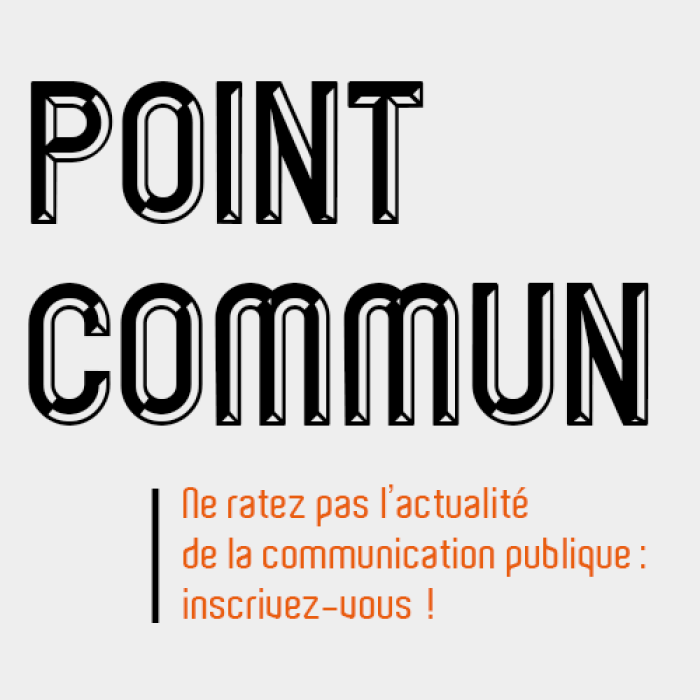IA, vidéo, fatigue informationnelle... : les enseignements du Festival de l’info locale
Chaque année, les médias locaux réunis à Nantes pour leur Festival de l'info locale (FIL) partagent leurs réflexions et pratiques. Deux journées nourrissantes pour les communicants territoriaux – partie prenante de l'écosystème médiatique de leur territoire. Retours d’expérience concrets sur l'IA, tendances vidéo, évolution du paysage de l'info locale, lutte contre la fatigue informationnelle, scrutin local majeur en approche... tirons le « Fil » de l'édition 2025 pour tisser de nouvelles idées dans les collectivités.
Les atouts de la newsletter, de Facebook, ou de la vidéo et de YouTube, l’importance de l’incarnation, les usages opérationnels de l’IA, la fatigue informationnelle, et les élections locales en approche… Dans les couloirs du Festival de l’info locale (FIL) 2025 à Nantes, il y avait comme un écho avec les échanges une semaine plus tôt aux Rencontres de la com numérique à Rennes. Les communicants rennais sont d’ailleurs venus partager au FIL leurs bonnes pratiques pour se mettre à l’accessibilité numérique. Mais cette année, c’était surtout parmi les participants que se trouvaient des communicants de départements, villes et métropole, du territoire nantais et d’ailleurs, venus tirer le « Fil » des usages des médias locaux pour affiner leurs pratiques et leurs supports. Déroulons la bobine pour les autres.
IA : exploiter les contenus et gagner du temps de journaliste
Sans surprise, l’IA était à nouveau largement au programme, avec plusieurs retours d’expérience concrets et des boîtes à outils. Plusieurs médias ont témoigné d’une utilisation concrète dans leur rédaction qui permet optimisation et réactivité dans l’utilisation des contenus produits par leurs journalistes.
Ainsi, l’exemple d’Ici (ex-France Bleu), qui utilise l’IA pour scanner ses 44 émissions locales du matin et fournir à la rédaction de son édition du midi des contenus et témoignages. Le principe : passer de l’audio extrait au format texte à l’aide d’un outil IA de transcription, ensuite intégré dans NotebookLM (outil de recherche et de prise de notes). L’IA analyse le contenu pour permettre par exemple de trouver à l’aide de l’horodatage le témoignage d’une personne dans l’un des territoires couverts par le réseau Ici. Après un test sur une thématique santé en octobre 2024, le procédé a été utilisé in situ pour la première fois le 15 novembre 2024 pour couvrir les manifestations des agriculteurs. Il a permis de passer les témoignages recueillis le matin en direct au Premier ministre invité de l’émission de la mi-journée, et de lui faire un point de situation à chaud dans toute la France.
De son côté, La Dépêche du Midi dispose depuis deux ou trois ans d’une IA Factory qui travaille autour de trois priorités :
- augmenter la qualité (correction, amélioration des copies…),
- augmenter l’efficacité : être sûr d’être lu avec des outils pour savoir si un article fidélise, fait de l’audience ou génère de l’abonnement,
- gagner du temps de journaliste en se défaisant de tâches techniques.
Le média utilise lui aussi NotebookLM, outil créé par un journaliste du Google Lab, qui voulait réutiliser toutes ses notes papier et numériques tout en préservant la qualité et l’authenticité de ses sources. En implémentant l’ensemble des articles et notes produits depuis le début de l’affaire Jubillar, les journalistes de La Dépêche peuvent ainsi écrire des papiers avec des angles spécifiques alors que le procès bat son plein.
L’IA open source comme alternative
NotebookLM permet d’utiliser sa propre base de connaissances pour générer des podcasts, FAQ chronologies, etc. Mais Ici comme La Dépêche restent cependant vigilants, vérifient les contenus rendus par l’IA pour éviter notamment les erreurs de transcription et vont confirmer, comme pour toute autre source, la véracité d’un témoignage avant d’extraire un audio pour une émission par exemple. Autre problématique soulevée par son appartenance à la sphère Google : l’outil est pour le moment gratuit mais jusqu’à quand ? Et quid de la confidentialité ? Dans le cas d’Ici, la question ne se pose pas sur les émissions radio qui sont toutes publiques et accessibles en ligne. Et NotebookLM indique a priori assurer une confidentialité stricte des données utilisateurs. Elles ne sont pas utilisées pour entraîner l'IA, et ne sont pas visibles par d'autres utilisateurs, car stockées dans un environnement cloisonné pour chaque utilisateur. Mais difficile de savoir dans quel pays se situent les serveurs de stockage...
L’alternative se trouve peut-être dans l’open source avec Open Notebook. C’est l’un des items de la boîte à outils IA opensource Essential AI Toolkit for Journalists and Content Creators présentée depuis le Québec par Florent Daudens de Hugging Face qui travaille à l’appropriation des outils IA en journalisme. « Les outils no code sont facilement utilisables. Mais ensuite il faut commencer l’internalisation des compétences et identifier des mutualisations possibles entre groupes de presse par exemple pour pouvoir accélérer. » Oui mais « comment faire pour s’y mettre ? », l’interroge une participante. Il répond en quatre étapes :
- disséquer comment on produit l’info ;
- identifier quel est le degré de non-éditorial à chaque étape de production ;
- décider quelles tâches on veut réaliser avec l’IA en se posant aussi les questions de confidentialité, de sécurité, d’éthique... ;
- voir comment on garde l’humain dans la boucle.
Miser sur la vidéo : un choix payant pour les médias locaux ?
C’était la question au cœur d’une table ronde réunissant plusieurs acteurs du secteur. Tous ont souligné le rôle désormais incontournable de la vidéo, en particulier pour toucher les jeunes publics et incarner davantage les sujets traités. Ils identifient plusieurs formats qui fonctionnent :
- les formats verticaux et notamment les shorts, qui permettent à des médias comme Le Parisien de toucher ceux qui aiment regarder ce type de format sur les réseaux ;
- les formats longs qui fonctionnent bien, à l’instar de Kaizen d’Inoxtag qui vient d’ailleurs de sortir un deuxième film sur YouTube ;
- le podcast filmé : l’écoute sur YouTube est plébiscitée, même avec seulement une image fixe. Le podcast vidéo permet en outre une surexploitation du format en capsules, teasers…
Mais le débat a aussi mis en lumière un certain malaise : celui d’un possible fossé générationnel : « Il faut recruter des jeunes qui maîtrisent les codes de la vidéo plutôt que de s’en tenir aux méthodes journalistiques traditionnelles », a résumé l’un des intervenants. Une remarque qui illustre les tensions entre pratiques établies et nouveaux usages. La discussion a également soulevé des interrogations sur l’éthique des médias émergents. Un représentant d’une plateforme vidéo en ligne, après avoir affirmé que « tout le monde peut être journaliste », a expliqué que ses équipes réalisaient parfois des capsules publicitaires conçues pour ressembler à des contenus d’information, brouillant ainsi la frontière entre communication commerciale et production journalistique.
En proximité, réapprendre à écouter ?
Au cœur du Festival, un grand débat, ouvert au grand public, a abordé la problématique du « ras-le-bol des médias » ou fatigue informationnelle, telle que l'avait théorisée la Fondation Jean-Jaurès dans une étude dont l’un des coauteurs, David Médioni, était présent. En renouvelant cette étude début 2025, il a constaté le passage de la fatigue à l'exode informationnel. « Certaines personnes n’ont pas de problème à vivre sans s’informer. La réalité à laquelle ils croient n’est pas celle de l’information. [...] Ils ont l’impression d’accéder à l’information mais n’y comprennent rien. » « 40 % des gens évitent plus ou moins l’info, selon Reuters », confirme Gilles van Kote, directeur délégué aux relations avec les lecteurs au Monde et animateur du débat. « Les autres se sentent noyés et ont un sentiment d’impuissance. » David Médioni voit trois piliers de solutions :
- individuel : faire son « bilan carbone informationnel » ;
- pour les médias et formats : travailler sur la temporalité, les alertes, les newsletters et le contrôle des réseaux sociaux. « Selon l’étude de la Fondation Jean-Jaurès, les moins fatigués lisent Le 1, la matinale du Monde ou la newsletter Brief.me » ;
- une parole publique raisonnée : arrêter d’aller systématiquement sur les plateaux TV, et éviter le sensationnalisme.
Et plus généralement :
- faire une campagne pour sensibiliser à moins d’info ;
- introduire un module d’éducation aux médias dans les programmes scolaires du CE2 au bac ;
- et trouver des solutions pour que toutes les plateformes et IA aient les mêmes obligations que les médias traditionnels.
Le journalisme est presque un métier du lien. La question, c’est : faire barrage ou faire pont ?
Nina Fasciaux, directrice des partenariats chez Solutions Journalism Network
Pour Charlotte Vautier, journaliste indépendante et créatrice de contenu, un certain nombre de journalistes se parlent parfois entre eux, ce qui crée des moments médiatiques loupés. « Il faut se mettre à la place des lecteurs », abonde Samuel Petit, rédacteur en chef du Télégramme. « Quand on sait à qui on parle (et la data le permet), on se demande ce qu’ils veulent. »
Pour Nina Fasciaux, directrice des partenariats chez Solutions Journalism Network, « les journalistes ne savent plus écouter ». Un constat qu'elle a dressé après la première élection « surprise » de Trump puis lors des manifestations des gilets jaunes. Pour autant « il ne s’agit pas de mettre de la pommade. Mais d’écouter la vraie souffrance derrière, qui est l’impuissance […]. Le local a un superpouvoir : sa proximité. Le journalisme est presque un métier du lien. La question, c’est “faire barrage ou faire pont” ? Quand on donne la parole ou qu’on parle de quelqu'un, on signifie qu’il compte. […] Encore faut-il choisir ses mots et en cela les sciences comportementales permettent de voir comment ils sont reçus. »
Municipales : quels contenus pour susciter de l’intérêt ?
À quelques mois des scrutins locaux, la question du traitement des élections, « les JO de la presse locale », était largement au programme de ce Festival.
Pour capter l’attention de leur lectorat, les médias locaux choisissent souvent d’orienter leurs articles autour d’une question simple et concrète : qu’est-ce qui va changer si tel ou telle candidat(e) est élu(e) ? Cette approche peut prendre plusieurs formes : interroger directement les candidats sur leurs projets, ou encore suivre et vérifier si les promesses formulées dans les professions de foi des majorités en place depuis les municipales de 2020 ont été tenues.
Au-delà du suivi de campagne, un travail de pédagogie s’impose également. Les journalistes ont en effet un rôle essentiel à jouer pour expliquer les compétences d’une commune et de son intercommunalité, mais aussi les nouvelles règles du scrutin.
Médiacités a eu recours à l’intelligence artificielle pour passer au crible l’ensemble des délibérations votées dans plusieurs grandes villes où le média est implanté. Objectif : dresser un tableau de bord précis et concret des décisions prises par les élus. Cette analyse permet de faire émerger les grandes thématiques débattues, de repérer d’éventuels quartiers laissés de côté et de mettre en lumière l’ensemble des acteurs impliqués.
Enfin les intervenants étaient unanimes pour affirmer que l'équité de traitement des listes candidates demeure primordiale.
Au-delà des suivis des programmes des candidats, des bilans des élus et des politiques publiques, la couverture des élections par les médias locaux donne aux communicants publics quelques bonnes idées réplicables sur d’autres sujets dans leurs médias. En voici certaines présentées par Arnaud Wery, webjournaliste dans la PQR belge.
- Le SEO en fil rouge tout au long de la campagne pour améliorer son référencement, et l'utilisation de Discover.
- Répondre aux questions, même celles qui portent sur des infos pratiques, notamment avec une rubrique « Posez vos questions » dont la matière peut être réutilisée dans des « video explainers ». Cela permet notamment de toucher les primo-votants.
- Miser sur l’engagement et le participatif : avec l’installation d’une caravane dans les villes pour recueillir des témoignages utilisés ensuite sur un dossier avec grand témoin édito, analyse et témoignages, et en série et sur le numérique.
- Pour les chiffres et graphiques, s’attacher à répondre à la question « Qu’est-ce que j’en retiens ? ». Et compléter, illustrer sur un des aspects saillants (aller chercher par exemple une commune parmi les plus taxées et voir pourquoi).
- Des newsletters par commune, ou spéciales.
- Rendre service : avec des modules pour la liste des candidats, les résultats, les infos pratiques.
- Favoriser le débat (outil utilisé dans son média : Logora).
- Collaborer avec les écoles de journalisme.
- Et avoir toujours dans l’idée de donner la parole.
De « nouveaux » acteurs de l’info de proximité
Une animatrice d’un groupe Facebook ultralocal, un créateur de contenu et blogueur local, et un influenceur météo : trois intervenants qui ne sont pas journalistes mais jouent un rôle dans le paysage médiatique local ont présenté leur travail et leur rapport à leur audience. Un contact direct, parfois en hyperproximité, qui irrigue leur manière de créer des contenus : avec responsabilité, transparence, authenticité… et écoute. Des mots qui résonnent aussi à l'oreille des communicants locaux.